Nation
Tentative d’évasion à la prison de Makala : Retour sur ce drame…
Published
1 an agoon
By
La redaction
Le 1er septembre dernier, la prison centrale de Makala à Kinshasa a été secouée par un événement tragique. Une tentative d’évasion de grande envergure ayant entraîné une répression sanglante, faisant au moins 129 morts selon les autorités. Un bilan remis en question par les organisations non gouvernementales comme la Fondation Bill Clinton pour la paix, qui conteste ce chiffre, estimant qu’il pourrait être bien plus élevé.
La genèse des événements
Dans la nuit du 1er septembre, des coups de feu ont retenti dans l’enceinte de la prison. D’après certaines sources, des détenus affiliés aux « Kuluna », une bande criminelle redoutée à Kinshasa, auraient planifié cette évasion. Une coupure d’électricité soudaine aurait précipité les événements, plongeant la prison dans le chaos.
La réaction des gardiens, appuyés par des militaires, a été rapide et particulièrement brutale. Des rafales de tirs ont été dirigées contre les détenus, provoquant de nombreuses pertes humaines.
Les images effroyables capturées cette nuit-là ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant des corps éparpillés sur le sol, des cris de panique et des scènes de désespoir. La diffusion de ces vidéos a provoqué une onde de choc, tant au niveau national qu’international, suscitant des appels à une enquête approfondie pour faire la lumière sur ce massacre.
Un bilan controversé
Le gouvernement congolais a avancé un bilan de 129 morts, dont 24 par balles, et environ 50 blessés. Cependant, plusieurs ONG, dont la Fondation Bill Clinton pour la paix, affirment que le nombre de victimes serait bien plus élevé. Selon des témoignages recueillis sur place, des centaines de corps auraient été évacués de la prison ce soir-là, bien au-delà des chiffres annoncés. Il est également rapporté que certains de ces corps auraient été enterrés sans que les familles n’en aient été informées, renforçant l’opacité qui entoure cette tragédie.
Un autre aspect tragique de cette nuit concerne les violences sexuelles. Selon la Fondation Bill Clinton, plus de 200 femmes du pavillon 9, auraient été violées lors de cet événement, un chiffre qui n’a pas été confirmé par les autorités.
Où sont les prisonniers manquants ?
Une des principales zones d’ombre concerne le nombre exact de détenus présents à la prison avant et après l’évasion. La prison de Makala, construite pour accueillir 1 500 prisonniers, en abritait plus de 15 000 au moment du drame. D’après un rapport publié le 5 septembre par la Fondation Bill Clinton, il restait seulement 13 009 détenus après l’événement. Si l’on soustrait les 129 morts officiels et les 100 prisonniers transférés à la prison militaire de Ndolo, il manque tout de même près de 1 767 détenus. Là encore, les autorités n’ont pas apporté d’explications claires. Des interrogations demeurent sur ces disparitions : s’agit-il de personnes qui se sont échappées discrètement ou bien de victimes non recensées ? L’absence d’informations précises alimente les spéculations et accentue la méfiance de la population.
Une prison au bord de l’effondrement
La situation de la prison de Makala est le reflet des dysfonctionnements du système carcéral en RDC. Cette prison, construite en 1957, souffre d’une surpopulation chronique et de conditions de vie déplorables. Le manque de soins, la malnutrition et l’insalubrité y sont monnaie courante. En 2022, près de 500 détenus y seraient décédés à cause de ces conditions précaires.Cette prison est devenue tristement célèbre pour ses évasions collectives. En 2017, une évasion massive avait déjà eu lieu à Makala, orchestrée par des membres de la secte Bundu Dia Kongo, permettant à des milliers de détenus de s’enfuir, y compris leur leader spirituel Ne Mwanda Nsemi.
Aujourd’hui, la prison héberge plus de dix fois sa capacité maximale. Ce problème de surpopulation, associé à une gestion déficiente, rend la situation encore plus explosive. Plusieurs ONG ont déjà alerté les autorités sur ces conditions, mais peu de choses ont été faites pour y remédier.
Des attentes face aux enquêtes
L’incident de Makala a suscité une vague d’indignation au sein de la population, qui attend des réponses. Le président Félix Tshisekedi avait promis une enquête rapide pour faire la lumière sur ce drame, mais jusqu’à présent, peu de résultats concrets ont été présentés. Les familles des victimes réclament justice, et les organisations internationales, comme Human Rights Watch et Amnesty International, ont exhorté le gouvernement congolais d’agir en toute transparence.
De son côté, le directeur de la prison, Joseph Yusufu Maliki, a été suspendu de ses fonctions et fait l’objet d’une enquête. Selon certaines sources, il aurait quitté la RDC pour se rendre en Belgique pour des raisons médicales.
Une réforme pénitentiaire urgente
Le drame de Makala met en lumière l’urgence d’une réforme profonde du système carcéral en RDC. La construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires et la mise en place de programmes de réinsertion sont des étapes cruciales pour désengorger les prisons et améliorer les conditions de vie des détenus.
Si la tragédie de Makala a révélé des failles systémiques, elle appelle également à une réflexion plus large sur la gestion de la justice en RDC. Les autorités devraient prendre des mesures immédiates et concrètes pour rétablir la confiance du peuple et garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus.
Dominique Malala
You may like
Nation
Du Budget au Perchoir : le parcours insoupçonné de Boji Sangara
Published
7 jours agoon
novembre 20, 2025By
La redaction
Économiste de formation britannique, réservé mais d’une méthode implacable, Aimé Boji Sangara a gravi les échelons de la politique congolaise loin des projecteurs et des coups d’éclat. Son élection à la présidence de l’Assemblée nationale marque le couronnement d’un parcours où rigueur académique, loyauté stratégique et sens aigu du détail ont façonné un personnage rarement bruyant, mais dont l’influence est désormais centrale. Portrait d’un homme qui, loin de l’ostentation, privilégie l’efficacité structurelle et le travail de fond.
Le jour de son élection, le 13 novembre 2025, Aimé Boji Sangara n’a pas cédé à l’euphorie. Là où d’autres auraient levé les bras en signe de triomphe, il s’est simplement avancé vers le pupitre. Il affichait une concentration presque austère, révélant plus l’homme d’État mesuré que le vainqueur exubérant. Chez lui, la retenue n’est pas un artifice tactique : elle est l’expression profonde d’un trait de caractère qui est devenu sa marque de fabrique dans l’arène politique.
Lors de son discours d’investiture à la tête de la chambre basse, Boji a immédiatement cherché à rassurer et à projeter une image de réformateur pragmatique. Il a promis de transformer l’institution parlementaire en « un parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple », des objectifs qui nécessiteront une refonte interne des méthodes de travail et une collaboration renforcée, mais équilibrée, avec les autres institutions républicaines. Il a ainsi posé d’emblée les bases d’un mandat axé sur la rationalisation de l’action législative.
L’héritage politique du Kivu et l’exil académique
Né en 1968 dans le territoire de Walungu, au Sud-Kivu, Aimé Boji a été bercé par l’atmosphère du service public et de la politique. Son père, Dieudonné Boji, fut une figure respectée, notamment en tant que gouverneur du Kivu avant son éclatement en plusieurs provinces. Cette immersion précoce dans le sérail du pouvoir, loin d’engendrer une ambition politique prématurée, l’a plutôt orienté vers l’exigence de la méthode. Il s’est d’abord passionné pour la discipline des chiffres et la logique du raisonnement structuré. Après un diplôme de math-physique obtenu à Bukavu, il choisit de s’éloigner du tumulte national et de l’héritage familial pour poursuivre sa formation au Royaume-Uni.
Son voyage académique le mène d’abord à Oxford Brookes, puis à l’éminente Université d’East Anglia. Ces années passées outre-manche sont décisives. Il y acquiert non seulement un master en économie du développement, mais aussi un rapport au travail singulier : un culte de la méthode, de la recherche approfondie et de la gestion publique axée sur les résultats. Il s’engage ensuite dans des projets académiques et associatifs à Londres, se forgeant une réputation de professionnel sérieux, dont la rigueur et la précision, presque obsessionnelle, sont incontestables. Ces fondations jetées loin de Kinshasa expliquent sans doute sa capacité à rester serein et analytique face aux turbulences politiques.
Le technocrate au cœur de l’État
Lorsque Boji revient au pays au milieu des années 2000, c’est avec la conviction que son expertise doit servir l’appareil d’État. Élu député national en 2006, il est réélu sans discontinuer à chaque cycle électoral jusqu’à celui de 2023, faisant de son mandat parlementaire le socle de sa carrière.
Cependant, c’est au sein de l’Exécutif qu’il va véritablement affirmer son profil de technocrate fiable. Ses passages successifs aux portefeuilles du Commerce extérieur, du Budget et de l’Industrie sont remarqués par leur sérieux. Chaque nomination renforce l’image d’un homme capable d’écouter, d’analyser et de produire des résultats concrets, souvent mieux préparé sur le fond des dossiers que la moyenne de ses homologues.
Son mandat de quatre ans comme ministre du Budget est particulièrement éclairant. Il lui a permis d’acquérir une compréhension microscopique du fonctionnement de l’État, des rouages de la gestion des finances publiques et des impératifs de la transparence budgétaire. Malgré son passage prolongé au gouvernement, il n’a jamais renié ses années de parlementaire. « J’ai eu le privilège de siéger 13 ans durant dans cet hémicycle », a-t-il rappelé aux députés, soulignant qu’il y a appris la « noblesse du débat démocratique » et la valeur inestimable du consensus. Boji compte bien s’appuyer sur cette expérience bicéphale pour régénérer l’Assemblée. Il a clairement affiché sa volonté de replacer le député au centre de l’action parlementaire en privilégiant le travail de terrain et la proximité avec les réalités locales. Il souhaite notamment exploiter de manière plus systématique les rapports issus des vacances parlementaires pour identifier les besoins réels des circonscriptions et proposer au gouvernement des projets d’urgence concrets à financer en faveur des populations.
L’ascension stratégique : l’ancre de Tshisekedi
Dans un environnement politique souvent dominé par la théâtralité, les joutes oratoires et l’agitation, Boji incarne une forme de politique posée, presque administrativement efficace, qui tranche singulièrement. Ses collaborateurs le décrivent comme un homme qui « travaille en silence ». Le député Michel Moto, son camarade du parti politique Union pour la nation congolaise (UNC), le dépeint comme « un homme posé, conciliant et surtout un homme de dialogue », soulignant la dimension consensuelle de son leadership. Même ses détracteurs, en coulisse, concèdent volontiers qu’il « ne fait pas de vagues, mais il avance avec une détermination tranquille et méthodologique ».
Lorsque l’Union Sacrée de la Nation (USN) le désigne candidat au perchoir en septembre 2025, le choix n’est pas perçu comme audacieux, mais comme éminemment stratégique. Certains observateurs y voient un geste de prudence visant à installer une figure non clivante capable de gérer les dossiers techniques. D’autres y lisent une manœuvre pour stabiliser une institution qui a connu des périodes de crises internes et de vives tensions. Fidèle à lui-même, Boji mène sa campagne loin de l’agitation : il consulte, écoute, prend des notes méticuleuses et propose un programme centré sur la modernisation de l’institution. Son score, 413 voix sur les 423 votants, est un plébiscite qui témoigne de sa capacité à rallier un large consensus au-delà des chapelles politiques.
Un secret de polichinelle : la loyauté au Président
Le rapprochement entre Aimé Boji et le chef de l’État, Félix Tshisekedi, est l’élément fondamental qui explique cette ascension. Longtemps discret, il est devenu un secret de polichinelle au lendemain de sa démission du ministère de l’Industrie pour se présenter au Perchoir.
Un politologue souligne l’évidence de la stratégie : « Personne ne risque de quitter un portefeuille ministériel, surtout d’État, s’il n’a pas la certitude absolue d’avoir le soutien total du chef de l’État pour le Perchoir. Le fait qu’il ait quitté ses fonctions était le signe irréfutable de l’aval présidentiel. » Boji est l’homme clé chargé de garantir la cohésion et la productivité du pouvoir législatif au service de la vision présidentielle. Cette nouvelle proximité a d’ailleurs éclipsé l’influence de son mentor politique historique, Vital Kamerhe (VK), chef de l’UNC. Pressenti pour succéder à VK qui avait démissionné du Perchoir, Boji a réussi, depuis 2019, à gagner la confiance durable de Félix Tshisekedi, se positionnant comme un pilier fiable et loyal au sein de l’USN, essentiel à la matérialisation des ambitions de la majorité.
Des dossiers explosifs et un leadership à affirmer
Aimé Boji arrive à la tête de l’Assemblée nationale à un moment charnière. Les défis qui l’attendent sont considérables :
Il devra d’abord œuvrer en étroite collaboration avec l’Exécutif pour soutenir les efforts visant au rétablissement urgent de la paix et de la sécurité dans l’Est du pays. C’est la priorité nationale absolue qui pèsera sur tous les travaux législatifs. Au-delà, l’examen du budget 2026 est un travail technique colossal qui attend immédiatement la chambre basse pour garantir un budget réaliste, social et transparent, conforme aux promesses de l’Union Sacrée.
Enfin, un dossier potentiellement explosif pourrait faire un retour remarqué dans le débat parlementaire : la modification ou le changement de la Constitution. Dans son premier discours, Boji a déjà fixé un cap, sans éclats, mais avec une conviction de fer : moderniser l’institution et renforcer le dialogue constructif avec l’Exécutif. S’il réussit à créer un environnement de travail serein et à mettre les députés à l’aise par son style non conflictuel, un projet sensible comme celui de la révision constitutionnelle pourrait être abordé au sein de l’Union Sacrée avec moins de friction et plus de consensus technique.
En attendant, l’homme a fait des promesses sobres, presque techniciennes, mais parfaitement cohérentes avec sa personnalité. Aimé Boji n’est pas de ceux qui cherchent la lumière. Pourtant, le voici propulsé au cœur battant de la scène politique congolaise. Son défi majeur sera d’imposer son style : calme, méthodique, et parfois déroutant de discrétion, mais d’une efficacité que l’on dit redoutable. Reste à savoir si cette ascension tranquille saura se transformer en un leadership audacieux et assumé face aux enjeux colossaux qui attendent la République. Le Congo, lui, n’attend que de voir.
Heshima
Nation
RDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha
Published
1 semaine agoon
novembre 17, 2025By
La redaction
Réunis sous l’égide du Qatar, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et les représentants de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC-M23) ont signé le 15 novembre 2025 un Accord-cadre inédit visant à ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable dans l’est du pays. Ce texte, qualifié de « première étape décisive » par les médiateurs, doit maintenant être suivi de discussions techniques sur la démobilisation et le retrait des combattants. Heshima Magazine explore les différents points de ces protocoles.
Après plusieurs sessions de discussions sans issue, les autorités congolaises et les rebelles de l’AFC/M23 ont finalement franchi une nouvelle étape dans le processus de paix que pilote le Qatar depuis le mois de mars. Cet Accord-cadre comporte 8 protocoles qui déterminent les matières à traiter et les modalités de leur mise en œuvre afin d’aboutir à un accord de paix définitif. Heshima Magazine explore chaque engagement souscrit par les parties dans cet accord-cadre.
Échange de prisonniers sous supervision internationale
Bien que toutes les négociations impliquent des concessions de la part des parties, l’engagement sur l’échange des prisonniers est délicat pour le gouvernement. La plus grande préoccupation sur ce point réside dans la nature des prisonniers à échanger. Si le gouvernement peut s’attendre à la libération des militaires arrêtés par la rébellion lors des combats, l’AFC/M23, de son côté, pourrait élargir la liste à des individus auteurs de crimes graves. Certaines sources évoquaient même des personnalités comme le député Edouard Mwangachuchu, condamné notamment pour détention d’armes à feu. Pour le gouvernement, il est hors de question que tous les individus soient libérés dans ce cadre. « Nous allons nous assurer qu’on applique les critères d’exclusion sur des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes graves selon le droit international », avait déclaré le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa.
En septembre, Kinshasa et l’AFC/M23 ont signé ce « mécanisme d’échange de prisonniers ». Dans le cadre de ce dispositif, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) jouera le rôle d’intermédiaire neutre pour l’identification, la vérification et la libération sécurisée des détenus des deux camps. Le mouvement rebelle évoque environ 700 personnes arrêtées par Kinshasa. La mise en œuvre du mécanisme implique l’établissement et la certification des listes de prisonniers, avec l’aval de toutes les parties.
Si l’AFC/M23 s’attend à des têtes couronnées telles que Éric Nkuba alias Malembe, arrêté en Tanzanie puis condamné à mort à Kinshasa notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel, le gouvernement, quant à lui, s’attend à la libération d’environ 1500 militaires congolais capturés et envoyés par la rébellion en janvier et février derniers au camp militaire de Rumangabo pour un « reconditionnement ». Même si plus d’une centaine d’entre eux ont réussi à s’échapper des mains de la rébellion, certains restent encore captifs. D’autres combattants cantonnés au quartier général de la MONUSCO avaient déjà été transférés de Goma à Kinshasa en avril grâce à la médiation du CICR. Sur ce point de libération des prisonniers, il reste à savoir si le gouvernement s’en tiendra toujours à son caractère « rigoureux » dans le choix des prisonniers à libérer en faveur de l’AFC/M23.
Mise en place d’un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu
Depuis le 14 octobre, le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC-M23 ont signé ce « mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu » dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Ce mécanisme institue un comité constitué d’un nombre égal de représentants du gouvernement congolais et de l’AFC/M23 afin d’enquêter sur les violations signalées. Les membres de ce comité devraient se réunir à la demande de l’une des deux parties en cas de violations signalées. Le Qatar, les États-Unis et l’Union africaine pourront y prendre part en tant qu’observateurs et la MONUSCO lui fournira un appui logistique. La première réunion du comité était censée se tenir dans les sept jours suivant son institution.
Lors de la signature de cet engagement, Doha avait qualifié la mise en œuvre de ce comité de suivi d’« étape cruciale vers le renforcement de la confiance et la conclusion d’un accord de paix global ». De son côté, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, avait salué sur le réseau social X « une avancée significative ». Mais sur le terrain, ce mécanisme a accusé des faiblesses. Les deux camps ont continué à s’affronter sans que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu ne puisse s’activer. Par communiqué interposé, les deux camps s’accusent mutuellement de violation de ce cessez-le-feu. Tant que l’accord global n’aura pas intervenu, ce mécanisme – sans la bonne foi des parties – aurait du mal à fonctionner.
Restauration progressive de l’autorité de l’État dans les zones occupées
Ce point, qui figure dans l’Accord-cadre qui vient d’être signé, reste le plus difficile à digérer pour les rebelles de l’AFC/M23. Au début des discussions à Doha, cette rébellion voulait obtenir la gestion des zones conquises en collaboration avec le gouvernement à Kinshasa. Une option qui était dénoncée par l’opinion publique, la percevant comme une balkanisation du pays. La restauration de l’autorité de l’État, l’un des points clés de divergence dans les discussions, passe pour un arrêt de mort pour l’AFC/M23 dont l’avenir post-occupation n’est toujours pas décidé à Doha. Sur la question de la restauration de l’autorité de l’État, la Déclaration de principes signée entre les deux parties en juillet dernier notait que cette restauration de l’autorité de l’État allait constituer une conséquence logique du règlement « des causes profondes » du conflit. L’accord de paix global attendu devra préciser les modalités et le calendrier de cette restauration sur l’ensemble du territoire national.
Retour sécurisé et volontaire des réfugiés et déplacés
C’est l’un des sept points de la Déclaration de principe publiée le 19 juillet. Il a été également repris dans l’Accord-cadre du 15 novembre 2025. Les deux parties s’engagent à faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés et des personnes déplacées vers leurs zones ou pays d’origine. Mais combien sont-ils de part et d’autre de la frontière entre la RDC et le Rwanda ? Ce retour, qui doit se faire en conformité avec le droit humanitaire international et dans le cadre des mécanismes tripartites associant la RDC, les pays d’accueil et le HCR, pourrait aussi constituer l’un des problèmes dans la mise en œuvre de l’accord final. Ce sujet est aussi l’un des points les plus sensibles. Le retour des réfugiés congolais fait partie des revendications historiques du M23, déjà présentes dans l’accord de paix signé en 2009 entre Kinshasa et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), l’ancêtre du mouvement actuel. Problème : qui est Congolais et qui ne l’est pas ? Ces réfugiés, défendus bec et ongle par le M23, sont-ils en nombre conséquent ? Sur ce point, il faut d’abord régler la question des chiffres. Selon les dernières estimations avancées par RFI, le Rwanda accueille près de 137 000 réfugiés, principalement en provenance de la RDC et du Burundi. D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ 80 000 Congolais vivraient aujourd’hui au Rwanda. Mais pour Kinshasa, le problème reste l’identification : les autorités congolaises affirment ne pas connaître avec précision ni le nombre, ni l’identité de ces réfugiés. Pour le gouvernement congolais, on ne peut pas rapatrier des réfugiés dans une zone encore en conflit ou sous contrôle des rebelles du M23. Le gouvernement voudrait avoir le pouvoir nécessaire de contrôler l’identité de ceux qui veulent revenir au pays. Le vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani, alertait déjà sur une « transplantation » des populations venues d’ailleurs dans les zones contrôlées par les rebelles du M23.
Ce sujet fait craindre au gouvernement et à l’opinion l’arrivée d’une population compacte qui pourrait, un jour, exiger l’autonomie d’une des régions congolaises. Ainsi donc, Kinshasa insiste : le retour des réfugiés dans les zones aujourd’hui sous administration du M23 ne pourra avoir lieu qu’après le cessez-le-feu, la restauration de l’autorité de l’État et la vérification de la nationalité des candidats au retour. Autrement dit, cette question est loin d’être close. Elle pose aussi d’autres défis : quand ces réfugiés rentreront-ils ? Et où seront-ils installés ? Car il y a parmi eux des individus qui n’ont jamais mis les pieds en RDC. Des questions qui montrent, selon plusieurs experts, qu’il ne suffit pas de régler le volet sécuritaire, il faut un accord global, incluant aussi les aspects sociaux, fonciers et économiques. Les populations congolaises qui avaient fui l’arrivée du M23 dans leur zone avaient trouvé à leur retour des occupants venus d’ailleurs installés dans leurs maisons, cultivant également leurs champs.
Mesures de confiance
Ce point implique entre autres la communication entre parties, la fin de la propagande « haineuse » selon l’AFC/M23 et les libérations des prisonniers. Sur ce point, paradoxalement, rien ne rassure au regard des premières communications faites après la signature de cet Accord-cadre à Doha. « Cet accord ne comporte aucune clause contraignante », déclare Benjamin Mbonimpa, chef de la délégation de l’AFC/M23. Une communication qui annonce déjà que tout peut basculer à n’importe quel moment. « Il n’y a rien qui va changer sur le terrain », estime Bob Kabamba. Selon lui, il y a eu deux signatures qui n’ont pas produit des résultats sur le terrain. « Il faut s’inquiéter pour la suite car les deux parties se sont réarmées, elles se sont réorganisées », a-t-il expliqué, soulignant la mise en place par le M23 d’une administration parallèle qui fonctionne comme un État.
La relance économique et les services sociaux
Ce point du protocole de l’Accord-cadre est étroitement lié à la restauration de l’autorité de l’État. Un point qui reste parmi les plus difficiles à obtenir à Doha. Les rebelles ne veulent pas encore céder les zones sous leur contrôle sans connaître au préalable leur avenir politique et sécuritaire.
La justice, la vérité et la réconciliation
Alors que les combats se poursuivent dans l’Est du pays, Kinshasa et les rebelles laissent entrevoir, malgré des positions opposées, quelques signaux de réconciliation. Mais la méfiance reste profonde, et les conditions d’une véritable réconciliation demeurent toujours fragiles. La part de la justice dans cette démarche est essentielle pour ne pas laisser les bourreaux côtoyer les victimes. Cette réconciliation entre le gouvernement congolais et les rebelles AFC/M23 n’est pas impossible ; elle est simplement suspendue à une constellation de facteurs politiques, militaires et diplomatiques encore instables. Dans un conflit où chaque camp cherche une position de force, la paix reste pour l’instant un horizon plus qu’une réalité, mais un horizon que beaucoup, épuisés par des années de guerre, espèrent voir enfin se rapprocher.
Élaboration d’une feuille de route vers un accord de paix global
L’Accord-cadre de Doha fixe les bases d’un processus destiné à mettre fin aux hostilités, à rétablir l’autorité de l’État et à consolider la stabilité nationale. Il réaffirme la détermination du Gouvernement à placer la paix, la sécurité et la dignité du peuple congolais au centre de son action. C’est dans ce cadre que la protection des populations civiles, en particulier les femmes, les enfants et les personnes déplacées internes, demeure une priorité. Les protocoles qui découleront de cet Accord-cadre permettront notamment de sécuriser les corridors humanitaires, de faciliter l’accès des organisations humanitaires, et d’engager des actions urgentes pour répondre aux besoins essentiels des communautés affectées.
De son côté, le gouvernement précise que les six protocoles, en dehors de ceux relatifs au Mécanisme de libération des prisonniers ainsi qu’au Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, feront l’objet de discussions deux semaines après la signature de l’Accord-cadre. Il s’agira de préciser les modalités techniques, les calendriers d’exécution et les engagements respectifs des parties. Dans le communiqué du gouvernement, Kinshasa note qu’aucun statu quo n’est compatible avec cet objectif de paix : le processus engagé vise à créer, dans les plus brefs délais, les conditions d’un changement réel et mesurable pour les populations affectées. Les deux prochaines semaines vont permettre de percevoir les nouveaux efforts entre les deux parties.
Heshima
Nation
Neutralisation des FDLR en RDC : quels résultats en 30 ans ?
Published
2 semaines agoon
novembre 13, 2025By
La redaction
Pour mettre en œuvre l’une des résolutions phares de l’Accord de paix signé à Washington le 30 juillet 2025 entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont lancé, début novembre 2025, une vaste campagne de sensibilisation visant à pousser les combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) à déposer volontairement les armes. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie mixte combinant dialogue politique, désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), avec l’appui de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Mais sur le terrain, ces rebelles hutus rwandais semblent bien fantomatiques, leur présence réduite à une ombre résiduelle qui complique la mise en œuvre de ce volet de l’accord.
Depuis leur émergence officielle en 2000, les FDLR, nées des exilés hutus fuyant le Rwanda après le génocide de 1994, ont été au cœur d’une rhétorique rwandaise les présentant comme une menace existentielle, justifiant des décennies d’interventions militaires et d’ingérences. Pourtant, une analyse approfondie révèle que cette menace est largement exagérée, servant avant tout d’alibi à des ambitions économiques et territoriales plus prosaïques.
Walikale : une mission bredouille face à l’absence des FDLR
Le 5 novembre 2025, une délégation des FARDC, conduite par le général Sasa Nzita, chef d’état-major adjoint chargé des renseignements militaires, s’est rendue à Walikale, dans la province du Nord-Kivu, pour un meeting avec la population locale. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de l’accord de Washington, qui vise une paix durable par la neutralisation de ces rebelles rwandais. L’équation se pose avec acuité pour l’armée congolaise : les combattants FDLR ne sont plus présents sur l’ensemble du territoire de Walikale. D’après les témoignages recueillis auprès des habitants, ces éléments ont totalement disparu de la zone. La population a formellement rejeté l’allégation rwandaise selon laquelle la rive gauche de la rivière Lowa, en plein centre de Walikale, serait encore occupée par les FDLR, une affirmation qui, comme tant d’autres, semble sortie d’un manuel de propagande kigalie.
Le général Sasa Nzita a toutefois appelé les citoyens à s’impliquer activement dans cette campagne pour en assurer le succès, en sensibilisant d’éventuels combattants résiduels, s’ils existaient encore dans des recoins isolés de ce territoire. À l’issue de cette mission, l’officier est rentré bredouille : aucun combattant ne s’est rendu volontairement. Cette absence criante illustre la réalité d’un groupe qui, après trente ans de traque, s’est réduit à une présence sporadique, loin de l’image d’une armée d’invasion brandie par Kigali pour légitimer ses incursions répétées.
Bastions occupés par les RDF et l’AFC/M23 : l’impossible neutralisation
Les combattants résiduels de cette force négative étaient historiquement concentrés dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, au Nord-Kivu. Pourtant, ces trois entités sont en grande partie occupées, depuis janvier 2022, par les Forces armées rwandaises (RDF) et les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23), un groupe armé que les rapports des experts des Nations unies qualifient sans ambiguïté de soutenu par Kigali. En occupant ces territoires avec des moyens militaires largement supérieurs (blindés, artillerie, drones et contingents bien entraînés), le Rwanda et ses supplétifs auraient dû, en toute logique, neutraliser ces éléments FDLR s’ils représentaient une menace réelle et imminente. Cela n’a pas été fait officiellement, et pour cause : les FDLR, dans leur configuration actuelle, ne constituent plus aucun danger militaire pour le Rwanda. Au contraire, ils coexistent ou s’affrontent sporadiquement avec l’AFC/M23 dans des poches isolées, comme à Bwisha, dans le territoire de Rutshuru, où des accrochages récents ont été signalés.
Pour jouer pleinement sa partition, le gouvernement congolais, à travers l’armée, promet d’étendre la campagne de sensibilisation à d’autres territoires du Nord-Kivu, notamment Masisi et Rutshuru. L’objectif est clair : inciter la population à se désolidariser des groupes armés étrangers et encourager les combattants rwandais à se rendre volontairement auprès des FARDC ou de la MONUSCO. Mais dans un contexte où les RDF patrouillent ouvertement, cette extension risque de se heurter à la même opacité : comment sensibiliser des fantômes quand les vrais occupants du terrain sont les alliés de Kigali ?
Les FDLR exigent un dialogue inter-rwandais avant tout désarmement
Au cours d’une interview accordée à RFI le 8 novembre 2025, le lieutenant-colonel Octavien Mutimura, porte-parole des FDLR-FOCA (la branche armée du mouvement), a refusé catégoriquement tout désarmement unilatéral. Pour lui, il faut d’abord un dialogue inter-rwandais pour juger les causes profondes de leurs revendications. « On doit juger la cause de notre lutte armée. Nous sommes là pour nous protéger et protéger les réfugiés rwandais abandonnés. Remettre les armes sans que toutes les conditions soient réunies, c’est une utopie », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Nous sommes parmi les cibles de Kigali. Nous résisterons jusqu’à ce que Kigali admette un dialogue inter-rwandais et un retour des réfugiés en toute dignité. » Interrogé sur le nombre de combattants encore actifs en RDC, ce porte-parole est resté évasif, évoquant simplement qu’ils sont la cible des attaques de l’AFC/M23, une rébellion étroitement liée à Kigali. « Nous sommes dans les zones où se mènent les combats.
L’AFC/M23 nous attaque et menace nos réfugiés. Nous sommes dans l’obligation de les protéger », a-t-il ajouté. Selon lui, les FDLR se trouvent actuellement dans des zones contrôlées par l’AFC/M23, notamment à Bwisha, dans le territoire de Rutshuru, où elles affrontent régulièrement leurs adversaires. Pendant ce temps, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) poursuit le rapatriement de réfugiés rwandais vers le Rwanda, une procédure qui n’enchante guère les FDLR. « Les réfugiés, ce sont nos parents, nos enfants. On ne peut pas séparer une famille rwandaise comme ça. Certains des gens envoyés au Rwanda avec l’aide du HCR sont des Congolais. Et d’autres sont capturés, puis renvoyés de force. Nous accusons le HCR de jouer le jeu du Rwanda », a tonné Octavien Mutimura. Ces accusations soulignent une fracture profonde : les FDLR ne se voient plus comme une force offensive, mais comme un bouclier pour une communauté exilée, majoritairement composée de descendants de réfugiés hutus arrivés en RDC (alors Zaïre) après la prise de pouvoir du Front patriotique rwandais (FPR) en 1994. Parmi ces exilés se trouvaient à la fois des responsables du génocide, des militaires des ex-Forces armées rwandaises (FAR) et des miliciens Interahamwe, mais aussi des centaines de milliers de civils fuyant la répression. C’est dans les camps du Kivu que ces groupes se sont organisés, donnant naissance à l’Armée de libération du Rwanda (ALiR) en 1998, puis aux FDLR en 2000. Aujourd’hui, après trois décennies, le mouvement est bien loin de ses origines : ses rares tentatives d’attaque contre le Rwanda ont été insignifiantes et rapidement neutralisées, et ses activités se limitent à une survie précaire en RDC, marquée par des exactions contre les civils congolais : pillages, viols, enrôlement d’enfants soldats et exploitation illégale des ressources minières.
Trente ans d’opérations militaires : un bilan d’échecs répétés
En cas de refus de reddition, une neutralisation par la force ? Selon l’agenda décidé à Washington entre Kinshasa et Kigali, après la phase de sensibilisation à la reddition volontaire, il faudrait passer à des opérations militaires pour neutraliser ceux qui ne se rendront pas. Reste à savoir si ces opérations seront menées conjointement entre les FARDC et les RDF dans le cadre du concept d’opérations (CONOPS) défini à Washington. L’expérience des trois dernières décennies démontre que tant que les causes profondes ne sont pas traitées du côté du Rwanda notamment l’absence de dialogue politique inclusif et l’instrumentalisation persistante de la « menace FDLR », ces groupes parviennent toujours à se refaire comme une hydre.
Depuis deux décennies, plusieurs initiatives ont tenté de régler cette question sans succès majeur. En 2001, un premier processus avait conduit au désarmement et au cantonnement des combattants à Kamina, dans le Katanga, ainsi qu’à la destruction publique d’armes à Kinshasa, en présence de la communauté internationale, sous l’égide de la MONUSCO et de ses prédécesseurs. En 2014, plus de 1 500 combattants avaient remis leurs armes à la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et à la MONUSCO, avant d’être cantonnés, avec leurs familles, dans les camps de Kisangani, Kanyabayonga et Walungu, toujours sous supervision internationale. De 2009 à 2015, plusieurs autres opérations militaires conjointes entre les FARDC, les RDF et la MONUSCO ont été lancées dans l’Est de la RDC, conjointement ou impliquant seulement les FARDC. Parmi elles : Umoja Wetu en 2009, une offensive transfrontalière qui a visé les FDLR dans le Nord-Kivu mais78 a provoqué des déplacements massifs de population ; Kimia I et II en 2009-2010, qui ont ciblé les bastions des FDLR au Sud-Kivu, avec un bilan lourd en victimes civiles ; Amani Leo en 2010, une opération plus focalisée sur la protection des civils mais qui n’a pas éradiqué le groupe ; Amani Kamilifu en 2012, une extension de la précédente avec un accent sur le DDR ; et enfin Sokola II en 2014-2015, qui a tenté une approche mixte mais s’est heurtée à la résilience des FDLR.
Ces offensives ont provoqué des centaines de milliers de déplacés internes, plus de 1,2 million rien qu’entre 2009 et 2012, selon les estimations de l’OCHA et de nombreuses pertes civiles, estimées à des milliers, sans jamais régler définitivement la question. Pourquoi cet échec récurrent ? Parce que ces opérations n’ont jamais abordé les racines du problème : l’exil forcé post-1994, le refus de Kigali d’intégrer les Hutus dans un dialogue national, et surtout l’utilisation des FDLR comme prétexte pour des interventions qui masquent des intérêts bien plus tangibles. Comme quoi la solution pourrait passer aussi par des discussions avec Kigali autant qu’on impose des discussions entre l’AFC/M23 et le gouvernement congolais. « Il faut qu’ils mettent la pression sur Paul Kagame pour avoir un dialogue inclusif entre Rwandais. La solution en Afrique centrale, c’est que les présidents s’assoient et se parlent en toute franchise, pour que les peuples de la région vivent en paix et en symbiose », estime le porte-parole des FDLR. Visiblement, sans engagement sincère et suivi des promesses de réinsertion, incluant des garanties de sécurité pour les ex-combattants et un retour volontaire des réfugiés, la campagne de reddition des FDLR risque de rester une opération symbolique face à une crise qui, depuis 30 ans, ensanglante l’Est du Congo.
Une menace fantôme au service du pillage des ressources
Cette crise trouve ses origines dans l’exode massif de près d’un million de Hutus vers le Zaïre après la victoire du FPR en juillet 1994. Les camps de réfugiés au Kivu, comme ceux de Mugungu ou Kibua, sont devenus des foyers de réorganisation pour les ex-FAR et les Interahamwe, qui y recrutaient et s’entraînaient pour un retour armé au Rwanda. La première guerre du Congo (1996-1997), menée par le Rwanda et l’Ouganda, a dispersé ces camps, mais les survivants se sont repliés dans les forêts du Kivu, formant l’ALiR puis les FDLR.
Kigali a depuis systématiquement présenté ces groupes comme une menace génocidaire persistante, justifiant ses alliances avec des rebelles du RCD (1998-2003) au CNDP (2006-2009), en passant par le M23 (2012-2013 et depuis 2022) qui ont contrôlé les mêmes zones sans jamais lancer d’opérations décisives contre les FDLR. Le RCD, par exemple, a dominé les provinces du Nord et du Sud-Kivu pendant près de cinq ans avec des contingents RDF intégrés, disposant de moyens militaires écrasants. Pourtant, aucune offensive d’envergure n’a été menée contre les FDLR, suggérant que leur survie servait d’alibi idéal pour prolonger l’occupation rwandaise. Une contradiction flagrante émerge aussi de l’intégration d’anciens membres des FDLR au sein des institutions rwandaises : Paul Rwarakabije, ancien commandant en chef des FDLR, a été promu général dans l’armée rwandaise après sa reddition en 2012, et d’autres officiers ont suivi un parcours similaire. Comment un groupe peut-il être à la fois une « menace existentielle » et source de recrutement pour l’armée adverse ? Cette instrumentalisation est patente : après trente ans, il est hautement improbable que les ex-FAR impliqués dans le génocide de 1994 soient encore actifs. La majorité ont été tués, capturés, jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou ont simplement vieilli. Les FDLR actuelles sont composées en grande partie de jeunes recrues nées en RDC, sans lien direct avec 1994, perpétuant un mythe de « génocidaires toujours actifs » pour justifier l’impunité rwandaise.
Derrière cette rhétorique sécuritaire se cachent des objectifs géopolitiques et économiques bien plus pragmatiques. Le Rwanda, un petit pays enclavé et pauvre en ressources naturelles, est devenu ces dernières années un exportateur majeur de minerais stratégiques comme le coltan, l’or et la cassitérite. Selon les rapports du Groupe d’experts de l’ONU sur la RDC (notamment ceux de 2023 et 2024), une grande partie de ces exportations estimée à plus de 1 milliard de dollars par an, provient de l’Est congolais, extraite dans des zones contrôlées par des groupes armés soutenus par Kigali, dont les profits alimentent directement l’économie rwandaise.
Des circuits de contrebande sophistiqués transitent par le lac Kivu ou les postes frontaliers, finançant à la fois les RDF et leurs proxies. Stéphanie Wolters, chercheuse principale à l’Institute for Security Studies (ISS) et spécialiste des dynamiques régionales en Afrique centrale, le souligne avec clarté : « Le Rwanda a des ambitions territoriales claires dans l’Est de la RDC, où il exerce un contrôle de facto sur des zones riches en minerais, au détriment de la souveraineté congolaise. » Cette réalité, longtemps ignorée par la communauté internationale séduite par le « miracle économique » rwandais, explique pourquoi les FDLR, malgré leur faiblesse militaire, sont maintenues en vie comme un épouvantail commode. Sans elles, quel prétexte pour les incursions répétées et le soutien aux rebelles ? L’accord de Washington, s’il est appliqué avec sincérité, pourrait forcer Kigali à abandonner ce narratif, mais l’histoire montre que les engagements passés comme ceux de l’Accord-cadre de paix, sécurité et coopération pour la RDC et la région de 2013 ont été bafoués sans conséquences.
Trente ans après le début de cette tragédie, qui a coûté la vie à plus de 7 millions de Congolais, un bilan qui dépasse de loin les 800 000 victimes du génocide rwandais et représente près de quatre fois la population de Paris, plus de six fois celle de Bruxelles et plus de deux fois celle de Berlin, le drame humanitaire de l’Est congolais reste le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Des millions de déplacés, des famines récurrentes, des épidémies de choléra et d’Ebola exacerbées par l’insécurité, et un pillage systématique des ressources qui prive la RDC de ses richesses légitimes. Combien de victimes faudra-t-il encore pour que la communauté internationale cesse de cautionner cette rhétorique fallacieuse ? Combien de souffrances pour que l’on reconnaisse l’instrumentalisation meurtrière des FDLR et impose un règlement politique inclusif, incluant un dialogue inter-rwandais véritable et la fin de l’exploitation illicite ?
La RDC mérite enfin de se reconstruire dans la paix et la stabilité, sans que des puissances étrangères, à travers des manœuvres cyniques, n’exploitent ses ressources et ne maintiennent son peuple dans une éternelle souffrance. La mémoire des millions de victimes congolaises doit être un appel impérieux à la démystification urgente de cette menace fantôme et à la fin de cette tragédie.
Heshima
Trending
-

 International2 semaines ago
International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux
-

 Politique3 semaines ago
Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?
-
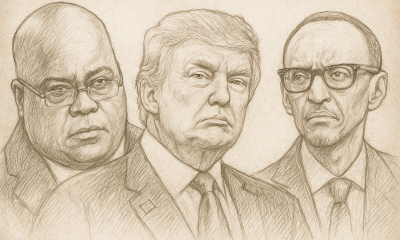
 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?
-
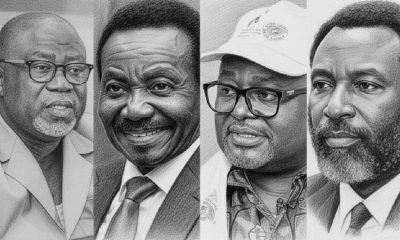
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu
-
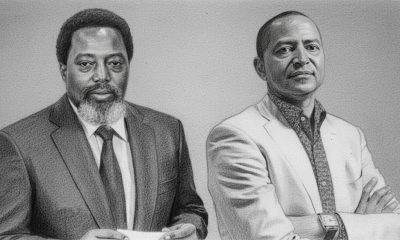
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?
-

 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA
-

 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?
-

 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha





























































