Le 16 novembre 2025, la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria s’affrontent pour une place précieuse aux barrages intercontinentaux pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Entre les Léopards et les Super Aigles, deux équipes africaines aux trajectoires contrastées, mais un dernier ticket pour ce rêve planétaire. L’Afrique retient son souffle…
Dans une demi-finale de barrage intense et indécise disputée à Rabat, la RDC a finalement renversé le Cameroun aux ultimes de la partie et s’est offert une place en finale des barrages africains qui donnera accès au ticket des barrages intercontinentaux prévus en mars 2026. Bien avant ce match, le Nigeria a dû batailler dur pour se défaire du Gabon. Longtemps accrochés, les Super Eagles n’ont fait la différence qu’en prolongation. Alors que les deux équipes étaient à égalité un but partout au terme du temps réglementaire, les Nigérians ont profité de la baisse de régime des Panthères pour s’imposer 4-1 au final.
Les Léopards plus affamés que les Lions
A Rabat, le 13 novembre 2025, l’atmosphère avait des airs de grande soirée africaine malgré la pluie. Camerounais et Congolais s’y retrouvaient pour un match qui, malgré son statut de barrage, avait tout du duel de prestige entre deux nations habituées aux joutes de haut niveau. Le Cameroun, fort d’un effectif expérimenté, entame la rencontre avec ambition. Mais très vite, la RDC impose son rythme, ses courses, son agressivité. Les Léopards pressent, étouffent et s’installent dans le camp adverse en première-temps. Ils se sont montrés plus affamés que les Lions indomptables, multipliant des actions vers le camp camerounais. Le premier but, logique, arrive sur une balle arrêtée parfaitement exécutée par Bryan Cipenga, conclue d’un tir croisé imparable par Chancel Mbemba au second poteau (90+2). Le capitaine des Léopards fêtait sa centième sélection lors de ce match. Une victoire congolaise qui intervient après 27 ans de domination du Cameroun sur la RDC.
Desabre vante son équipe malgré la pluie…
Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a vanté les qualités de son équipe qui a joué soudée malgré la météo. « C’était un match contre deux belles équipes d’Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie mais sur une très bonne pelouse. On a joué dix premiers matchs sur du terrain synthétique, ça nous fait du bien pour poser notre jeu sur de bonnes pelouses. On a nos vertus et l’organisation tactique qui s’en suit. On pouvait peut-être ouvrir le score avant mais voilà, on est content. La météo, c’était pour les deux équipes. Ça n’a pas perturbé la vivacité du jeu, ç’a mis un peu de punch dans la rencontre. », a-t-il indiqué après cette victoire.
D’après lui, les deux équipes avaient des chances égales en dépit de la météo, se disant content d’avoir vu Chancel Mbemba marquer sur ce coup de pied arrêté. « Nos joueurs sont comme eux, ils jouent en Premier League, ils en ont quand même l’habitude. Il y a eu du spectacle, nous avons eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. C’est ce qu’il y a à retenir de ce match, il ne s’est pas joué à grand-chose. Le fait que nous soyons assez soudés et patients quelques fois également fait qu’on a la réussite sur le corner. On était prêts. Je suis content que Chancel marque parce qu’on travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés. J’ai pris beaucoup de plaisir. J’ai été fier de coacher mes joueurs. », a-t-il fait savoir.
Rabat, témoin d’un tournant
La débauche d’énergie, la rigueur défensive et la solidarité affichées par les Congolais laissent entrevoir une équipe en pleine maturité. Si cette dynamique se poursuit, la RDC pourrait livrer un autre grand match face au Nigéria. Le Cameroun, malgré son expérience, a subi la fougue et la détermination adverse. Les Léopards, eux, ont offert une prestation alliant caractère et intelligence, deux qualités essentielles pour franchir – si tout va bien – les ultimes portes du monde qui restent devant cette sélection. Le dimanche 16 novembre, ce ne sera pas seulement un match : c’est la promesse d’un destin. Pour le Nigeria, la joie d’un retour sur la scène mondiale. Mais pour la RDC, la marche vers un rêve caressé depuis plus de 50 ans après l’unique participation du pays au mondial en 1974. Une chose est sûre : l’Afrique s’apprête à vivre une soirée dont elle parlera longtemps à Rabat. La capitale marocaine qui abrite ces matchs de barrage pourrait être témoin d’un tournant si la RDC parvenait à renverser la vapeur face aux Nigérians.
Eliminé, le Cameroun se tourne vers la CAN
Après la défaite du Cameroun le jeudi 13 novembre 2025, le sélectionneur camerounais veut tourner la page et se préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Marc Brys veut digérer et se lancer à fond pour cette compétition africaine prévue en décembre 2025 au Maroc. « Tout le monde est déçu mais ils doivent revenir tranquillement et mentalement surtout. On a le temps. On va être prêts [pour la CAN, Ndlr]. On va prendre le temps de digérer mais on sera motivés pour préparer la CAN. Je ne pense pas que ça va être une excuse, pour ne pas jouer une bonne CAN […] », a déclaré Marc Brys après le match. Le coach camerounais a justifié la défaite des Lions indomptables par un manque de sérénité de la part des joueurs. « On n’était pas assez serein devant le but. Avec Eyong qui est très talentueux et qui a mis beaucoup d’impact. Mais il était tellement excité et il a eu les occasions de marquer deux ou trois buts mais bon… C’est un très grand joueur et je suis content de l’avoir », a-t-il ajouté.
Pour ce match contre la RDC, Marc Brys n’avait même pas dévoilé publiquement la liste des joueurs convoqués pour ce rassemblement important. Le football camerounais est depuis plusieurs mois secoué par une crise interne entre la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et le sélectionneur belge. Ces dissensions internes pourraient avoir joué en défaveur de ces fauves.
Heshima


 International2 semaines ago
International2 semaines ago
 Politique3 semaines ago
Politique3 semaines ago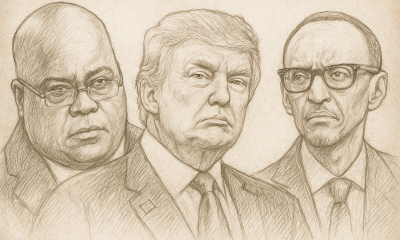
 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines ago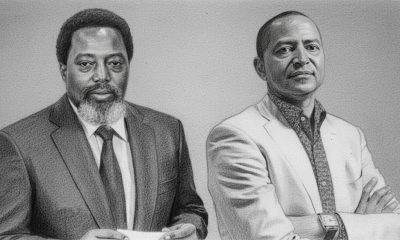
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago
 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine ago
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago































































