Non classé
Retour sur les différents projets de la CFEF avec la BAD
Published
10 mois agoon
By
La redaction
La Cellule d’exécution des financements en faveur des États fragiles (CFEF) a réalisé plusieurs projets avec le financement de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale. L’exécution de ces projets a eu un impact réel en République Démocratique du Congo (RDC), notamment en termes d’amélioration de la productivité agricole et de la qualité des infrastructures modernisées. La CFEF en qualité d’agence fiduciaire a notamment assuré avec satisfaction l’exécution du projet de construction d’un bâtiment moderne abritant les services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) de la Direction Générale des Impôts situé sur le Boulevard du 30 juin, à Kinshasa. La viabilisation des infrastructures de génie civil et de génie électrique de la Zone Economique Spéciale (ZES) pilote de Maluku fait également partie d’une des grandes réalisations faisant partie des composantes de nombreux projets exécutés.
De 2014 à 2024, de nombreux projets réussis ont été placés dans le portefeuille de la CFEF qui en assure la gestion fiduciaire. Il s’agit des projets ci-après : le Projet de Développement des Pôles de Croissance ouest (PDPC) financé par la Banque mondiale, le Projet de Renforcement des Systèmes de Développement Humain (PRSDHU) financé par la Banque mondiale, le Projet de Développement des Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) financé par la Banque mondiale, le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Modernisation des Finances Publiques (PAMRIM-FP) et le Programme d’Appui Budgétaire en Réponse à la crise de la COVID-19 (PABRC) financés par la Banque africaine de Développement.
En outre, la CFEF a participé aux négociations de nouveaux projets avec les partenaires techniques et financiers du Gouvernement. La CFEF exécute actuellement le Projet d’Appui à la Relance de l’Economie Congolaise (PAREC) financé par la BAD, le Programme de financement de microfinance – fonds d’urgence COVID-19 financé par la KFW.
La CFEF assure pour le compte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) plusieurs projets ayant trait à l’amélioration de la gouvernance et à la mobilisation des ressources internes.
Les interventions mises en place dans le cadre de ces projets, ont permis de renforcer la capacité des institutions, appuyées spécialement la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Recettes Administratives, judiciaires, Domaniales et de participations (DGRAD, à mobiliser les ressources internes, à améliorer les infrastructures économiques à travers l’appui au projet des ZES et des infrastructures rurales et d’assurer une gestion efficace des finances publiques à travers l’appui au Comité de suivi de réformes des finances publique (COREF). Ces projets ont également permis de mettre en place des outils et des mécanismes pouvant permettre le développement et la croissance des Petites et Moyennes Entreprises grâce notamment à la mise en place d’une ligne de crédit destiné au refinancement des banques commerciales et des institutions de microfinance à travers deux accords de partenariat signés avec le FPM SA et la Banque Centrale du Congo.
Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Modernisation des Finances Publiques (PAMRIM-FP)
Clôturé en 2022 et financé par la BAD à hauteur de 12 millions de dollars, le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et Modernisation des Finances Publiques (PAMRIM-FP) avait pour but de contribuer à la mobilisation accrue des ressources internes et au renforcement de l’obligation de rendre compte. Spécifiquement, le PAMRIM-FP visait à renforcer la mobilisation des ressources internes et de consolider les réformes fiscales. Dans ce cadre, les interventions déployées ont permis la réorganisation de l’Inspection des services de la DGI, la formation des Vérificateurs et Huissiers fiscaux et, enfin, la construction d’un bâtiment abritant les services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) de la Direction Générale des Impôts.
Réorganisation de l’Inspection des services de la DGI
La CFEF a mené avec l’appui d’un consultant la réorganisation de cette structure. Cette agence congolaise a mis en place un dispositif de gestion pour trois nouvelles structures de contrôle. En même temps, elle a élaboré une politique de gestion du parc informatique de la DGI.
Formation des Vérificateurs et Huissiers Fiscaux
Au total, 512 vérificateurs polyvalents et 340 gestionnaires des comptes ont été formés à travers les 26 provinces de la RDC.
Construction d’un bâtiment pour la DGE
Un cabinet a été recruté pour réaliser les études architecturales et superviser la construction d’un bâtiment de six étages (R+6) abritant la Direction des Grandes Entreprises (DGE) sur le Boulevard du 30 Juin. Selon le Coordonnateur National de la CFEF, Alain Lungungu Kisoso, ce bâtiment a été construit dans les normes. « Nous sommes fiers d’avoir participé à l’érection de cet édifice. Cela rentre dans le cadre de la modernisation des infrastructures publiques prônée par le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi », a-t-il déclaré en 2023. Les travaux de construction sont achevés depuis fin décembre 2023. A ce jour, le personnel de la DGE est déjà installé dans ce nouveau siège moderne.
Pérenniser les chaines des recettes en province
Dans le cadre de pérennisation des chaînes provinciales des recettes, dépenses et de la paie, la CFEF a fait installer des équipements informatiques et mis en œuvre un système intégré des finances publiques dans les provinces du Kongo Central, de la Tshopo et du Maniema. Les actions ont inclus l’installation des infrastructures physiques, c’est-à-dire, la mise en place des cellules de gestion des systèmes informatiques et démarrage de ce système dans les trois provinces. Il y a aussi la formation des agents. Sur ce point, 23 agents du Kongo Central et 40 agents de Kinshasa ont été formés sur l’usage et le paramétrage des modules du système des recettes, des dépenses et de la paie.
Achat des moyens de locomotion aux personnels
Le projet a permis d’améliorer la mobilité du personnel et des services de la Direction Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale des Recettes Administratives, judiciaires, Domaniales et de participations (DGRAD), de la Direction de Reddition Générale des Comptes (DRGC), de la Cour des Comptes et de la CFEF par l’acquisition de pick-up, bus, minibus et motos. Ce qui a facilité la mobilisation des recettes et le contrôle des administrations concernées.
Impact des actions de la CFEF

Les actions menées par la CFEF ont permis de renforcer la capacité des régies financières à mobiliser les ressources internes, les infrastructures économiques et assurer une gestion efficace des finances publiques. Selon la CFEF, ces réalisations témoignent de l’engagement de cette agence fiduciaire à soutenir le développement économique durable et inclusif promu en RDC par le Gouvernement de la République sous le leadership du Président de la République, transformant ainsi les défis posés par la crise en opportunités de croissance et de progrès pour les populations locales.
Le projet de Développement des Pôles de Croissance ouest (PDPC) est un projet multisectoriel ayant permis de libérer le potentiel de croissance des principaux secteurs productifs, en particulier l’agriculture et l’agro -industrie financé à hauteur de 110 millions de dollars par le Groupe de la Banque Mondiale. Il a été piloté par le ministère des Finances à travers la CFEF, comme unité de coordination du projet. Pour relever les défis liés à sa mise en œuvre, le PDPC s’est concentré sur certains des principaux moteurs du changement afin d’accroître la productivité et l’emploi des chaînes de valeur sélectionnées dans les zones ciblées. Les principaux facteurs de changement pris en considération étaient les suivants: le développement des chaînes de valeur agricoles aux fins d’améliorer les capacités d’approvisionnement agricole; le soutien aux infrastructures rurales; l’opérationnalisation de la Zone économique spéciale de Maluku via la facilitation des Partenariats Publics Privés – PPP; le renforcement des capacités de l’Agence des Zones économiques spéciales concernée dans le développement de la ZES et la viabilisation des infrastructures physiques. Le projet a également permis le développement proactif des affaires à travers un appui à l’Agence nationale de promotion des investissements dans la mise en œuvre des réformes réglementaires ciblées.
Renforcement des capacités d’approvisionnement agricole
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet a permis la réhabilitation des bâtiments de trois stations de l’Institut National des Etudes et Recherches Agronomiques (INERA) au Kongo Central ; la réhabilitation et équipement des laboratoires de l’INERA et du Service National de Semences (SENASEM) ; le renforcement des capacités technique et matérielle des intervenants de la chaîne semencière et la subvention de la production semencière certifiée ; la production de 46,9 tonnes de semences de base de riz par l’INERA et 79,5 tonnes de semences R1 mises à la disposition des organisations paysannes et opérateurs semenciers. Il y a eu également la production de 2 845 817,69 mètres-linéaires de boutures de manioc de base par l’INERA et 8 391 329 mètres linéaires de boutures primaires mises à la disposition des ménages agricoles par les opérateurs semenciers ; la production de 882.148 plants de palmier à huile a été mise à la disposition des producteurs paysans ; la structuration et professionnalisation de 49.853 ménages agricoles ; l’accroissement de la productivité moyenne de 0,8 tonne à 3,7 tonnes pour le riz et de 5 tonnes à 18,4 tonnes pour le manioc ; la production par les bénéficiaires directs du projet de 6.309 tonnes de riz paddy, 208.719 tonnes de racines de manioc et 11.722 tonnes d’huile de palme ; le financement à coûts partagés de 31 microprojets, en vue du développement des chaînes de valeurs agricoles au Kongo Central ; l’appui au Comité provincial de coordination et suivi du projet et installation de 6 Comités techniques locaux, composés au total de 54 membres, dont 37 % des femmes et enfin la réhabilitation et la construction du bâtiment de l’Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage.
Appui à l’infrastructure rurale
Pour permettre aux agriculteurs de mieux évacuer leurs produits, la CFEF, qui pilote ce projet, a renforcé les capacités techniques, matérielles et institutionnelles de la Direction nationale des Voies de Desserte Agricole (DVDA). Une stratégie provinciale d’entretien routier a été élaborée mais aussi un appui a été mis en œuvre au titre de l’institutionnalisation de la Commission provinciale routière et des comités locaux d’entretien routier. Le projet a permis la réhabilitation de 542,5 kilomètres de pistes rurales répartis sur 22 axes routiers dans le Kongo Central, avec la construction des 27 ponts, dont celui de Mambutu Kubu à Lukula, long de 36 mètres et de Lubolo, à Tshela, avec une longueur de 12 mètres et de 622 dalots, au bénéfice de 134 527 ménages ruraux. Les ressources du projet ont contribué à la construction et montage de 114 pylônes d’une ligne électrique haute tension de 132 Kilovolts dimensionnée en 220 Kilovolts de 36,5 km et de deux postes électriques à Lunga Vasa et à Moenge (132/30 Kilovolts). Au titre du projet, le Gouvernement de la République a construit et équipé la Plateforme agroindustrielle de Lukula (PAIL) pour une capacité annuelle de transformation de 9.000 tonnes de manioc, 9.000 tonnes de régimes de palmier à huile et 800 tonnes de riz paddy, financé l’aménagement hydroagricole du périmètre rizicole de Tshikenge à Boma (seuil de capture, canalisation de base et zone de production de 13 ha).
Zone Economique Spéciale (ZES) pilote de Maluku
Le projet a permis la sélection d’un emplacement pour la ZES pilote de Maluku, la réalisation des études y associées, la mise en place d’un cadre juridique institutionnel et réglementaire applicable aux ZES en RDC, ainsi que d’un établissement public chargé de la gestion des ZES, en l’occurrence l’Agence des Zones économiques spéciales. Ces réalisations se sont avérées essentielles dans la conception des activités et le développement du programme des ZES en République Démocratique du Congo. Le projet a ainsi financé l’élaboration des produits analytiques nécessaires à la viabilisation du site de la ZES pilote de Maluku, notamment l’étude d’impact environnemental et le Plan d’Action de Réinstallation (PAR), ainsi que la construction d’un mur de clôture de 6.150 mètres pour la sécurisation du périmètre de la ZES pilote de Maluku.
Développement proactif des affaires
Dans sa troisième composante, le projet s’est intéressé au développement proactif des affaires. Un appui institutionnel et matériel à l’ANAPI pour la réalisation des activités d’élaboration des réformes, de suivi-évaluation et de communication sur les 4 indicateurs Doing business ciblés par le projet. En effet, la réalisation d’une étude sur la stratégie d’appui aux PME et producteurs agricoles le long des chaines de valeurs agricoles du Kongo-Central, ayant permis notamment de : mettre sur pied un cadre de concertation public-privé sur les PMEs ; octroyer à 266 producteurs agricoles et PMEs de microcrédit dans les pôles nodaux d’Inkisi et de Kimpese ; ouvrir des comptes épargne à 40 coopératives agricole et 15 PMEs dans les pôles de Boma, connecter des producteurs agricoles de Khanzi aux transformateurs de Kinzau Mvuete. Ce projet a permis aussi la réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc agro-industriel à Nkundi, dans le Kongo-Central, comprenant un plan d’aménagement et de gestion ; l’élaboration d’un Programme de promotion ciblé de l’agro-industrie en RDC, PPCA, dans le cadre des directives stratégiques pour la promotion des investissements dans l’agriculture commerciale ; la réalisation d’une étude sur l’état des lieux du cadre actuel du dialogue public-privé et des solutions idoines pour le consolider ; réalisation d’une étude pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements pour les entreprises et organismes intervenant dans le commerce transfrontalier ; la réalisation d’une étude sur la rationalisation du système fiscal par la mise en place d’une fiscalité et d’une parafiscalité centrale et provinciale ; la réalisation d’une enquête d’impact et de satisfaction sur les 4 indicateurs Doing business ciblés par le projet et, enfin, la fourniture des équipements informatiques dans le cadre de l’informatisation du processus de délivrance du permis de construire.
Impact de ce projet en RDC
Les actions de la CFEF dans le cadre du PDPC ont eu un impact significatif, note la source, notamment en termes d’amélioration de la productivité agricole et de la qualité des produits grâce aux infrastructures modernisées. Les travaux de construction et de réhabilitation ont généré de nombreux emplois locaux, stimulant ainsi l’économie des zones ciblées couvertes par le projet.
De plus, la réhabilitation des pistes rurales a facilité l’écoulement des produits agricoles, améliorant l’accès aux marchés et réduisant ainsi les coûts logistiques pour les agriculteurs. Ces réalisations de la CFEF dans le cadre du PDPC illustrent son efficacité et son engagement à promouvoir le développement économique durable et inclusif en RDC. Par ses efforts continus, la CFEF au nom du Gouvernement de la République a réussi à transformer les infrastructures rurales et à améliorer les conditions de vie des populations locales, faisant du développement agricole une réalité tangible.
Le PRSDHU renforce des systèmes de santé et d’éducation

Réalisé de 2015 à 2020, le Projet de Renforcement des Systèmes pour le Développement Humain (PRSDHU) a été financé par la Banque Mondiale. Il avait pour objectif de renforcer certains systèmes de gestion des services de l’éducation et de la santé dans des zones géographiques ciblées en RDC.
Dans sa première composante, ce projet a formé 1 417 agents du Ministère de l’EPST, dont 226 femmes, et a fourni des équipements en matériel informatique, en panneaux solaires et divers aux 518 sous-divisions éducationnelles pour la collecte et le traitement des données.
En outre, dans le cadre du projet, les applications informatiques ont été développées et mises à la disposition de 48 divisions éducationnelles ciblées pour la collecte des données. Cet appui du projet a permis de produire et de rendre publics les annuaires statistiques et les plans d’action opérationnels des années scolaires 2015-2016, 2018-2019 de 518 sous-divisions de 48 divisions éducationnelles de l’EPST.
Système National d’Information Sanitaire (SNIS)
Dans le secteur de la santé, le projet a appuyé 62 zones de santé et les divisions provinciales de Santé (DPS) de 4 provinces (Haut Katanga, Mai-ndombe, Sud-Ubangi et Kwilu) dans l’intégration du SNIS, à travers l’équipement en matériel informatique et kits solaires. Aussi, le projet a formé 473 agents sanitaires, dont 58 femmes, dans les domaines relatifs à l’exploitation du système national d’information sanitaire (SNIS), en GPS, collecte des données Géospatiales et à l’utilisation du logiciel DHIS 2/SNIS amélioré. Par ailleurs, le projet a accompagné environ 129 zones de santé de six DPS dans la mise en œuvre, suivi et évaluation des activités, ainsi que dans la collecte et l’analyse des données de qualité. En conséquence, 118 rapports annuels et 168 plans d’action opérationnels (PAO) des zones de santé ont d’abord été produits et mis en ligne sur le site web du Ministère de la Santé publique (http://www.sante.gouv.cd) ; et ensuite 92 rapports annuels en 2019 et 126 plans d’action opérationnels (PAO) pour 2020 des zones de santé ont été mis en ligne sur le site web du Ministère de la Santé publique.
Enquête sur les indicateurs de prestation des services en santé et éducation
Le projet a soutenu la collecte et la construction des bases de données des écoles et des formations sanitaires (FOSA) dans le cadre des indicateurs de prestation des services (SDI) dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
Système de gestion de l’état civil
Grâce au projet, la stratégie de réforme du système d’enregistrement des faits d’état civil et de production des statistiques vitales, y compris son plan d’action et son budget, ont été élaborés et validés par les parties prenantes. Le projet a financé les échanges d’expérience sur terrain et a mis en place des centres d’excellence pilotes pour l’expérimentation du système informatisé d’enregistrement dans la commune de Limete à Kinshasa et dans le territoire de Mbanza-Ngungu dans la province du Kongo Central. Les innovations introduites dans la réforme ont conduit à la production de l’avant-projet du code de la famille révisé dans ses dispositions relatives à la personne, l’utilisation et la protection des données à caractères personnels, à l’interopérabilité entre les services de l’état civil et les structures médicales.
Dans sa deuxième composante, le projet a financé la mise en œuvre de 20 recommandations découlant d’une étude de l’OMS réalisée en 2014. La mise en œuvre de ces recommandations a donné lieu à la transformation de la Division de la pharmacie et du médicament (DPM) à une agence de réglementation autonome pérenne des produits pharmaceutiques essentiels, dénommée Autorité Congolaise pour la Réglementation Pharmaceutique (ACOREP).
Aussi, le projet a renforcé le Laboratoire Pharmaceutique de Kinshasa (LAPHAKI) en équipement, en formation et à la certification ISO 17025. En outre, un système d’information des acteurs du secteur privé, connecté à la SEGUCE, a été mis en place.
Système d’approvisionnement
Grâce à l’appui du projet, des plans d’affaires pour le développement de la Fédération des centrales d’approvisionnement en médicaments essentiels (FEDECAME), une organisation à but non lucratif, et des centrales de distribution régionale de Lubumbashi (CAMELU) et Goma (ASRAMES) ont été élaborés pour la préparer à gérer un volume considérable de passation des marchés.
Système de logistique
Le projet a appuyé le Programme National d’Approvisionnement en Médicaments essentiels (PNAM) dans l’évaluation rigoureuse du système actuel de logistique dans quelques provinces afin d’identifier une nouvelle organisation et un autre réseau logistique.
Au terme de cette évaluation, une stratégie nationale du système d’information pour la gestion logistique des médicaments (SIGL) a été élaborée avec la participation de toutes les parties prenantes ainsi que son plan d’action dans quelques provinces ciblées lesquelles ont été renforcées en capacité sur l’utilisation du logiciel DHIS 2 et du portail web « infomed.rdc.org »
Etudes
Cette troisième composante a porté sur la réalisation de deux études pour le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale (étude de la main d’œuvre qualifiée et étude sur les mutuelles de santé en RD Congo) ; la réalisation de 4 études et dissémination de 3 études du Ministère des Affaires Sociales (étude de transformation des CPS en CAS, étude de l’évaluation de la vulnérabilité en RD Congo et la revue des dépenses publiques en protection sociale). Les résultats de ces efforts ont été remarquables. Les systèmes de gestion de l’information dans les domaines de l’éducation et de la santé ont été considérablement renforcés, permettant une meilleure collecte, analyse et utilisation des données pour la prise de décisions éclairées. Les systèmes de réglementation et de logistique des médicaments essentiels ont également été optimisés, garantissant un approvisionnement plus fiable et efficace.
L’impact du PRSDHU se fait sentir dans les zones ciblées, où les communautés bénéficient désormais d’une meilleure gestion des services de santé et d’éducation. Grâce aux efforts de la CFEF, la RDC a fait des progrès significatifs vers l’amélioration de ses infrastructures sociales essentielles, posant ainsi les bases d’un développement durable et inclusif.
Les exploits de la CFEF dans le cadre du PRSDHU illustrent son efficacité et son engagement indéfectible à promouvoir le développement humain en RDC. En transformant des objectifs ambitieux en réalisations concrètes.
PDIFM, modernisation des infrastructures financières
Financé par la Banque Mondiale, le Projet de Développement des Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) a pris fin en avril 2021 et avait comme objectif de moderniser les infrastructures financières et à accroitre la disponibilité de financement pour les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Plusieurs actions ont été menées, permettant des réalisations telles que la construction du réseau de communication interbancaire et interconnexion de toutes les banques commerciales au réseau de communication interbancaire en janvier 2016 ; la fourniture à la Banque Centrale du Congo (BCC) du système multidevise ATS/CSD pour les opérations du nouveau système de paiements en janvier 2016 ; la mise en service de l’ATS/CSD et mise en production du système national de paiement modernisé le 29 septembre 2017; la formation de 1.040 personnes, membres de la BCC et des banques commerciales, dans les domaines de la connaissance et de la gestion de la fibre optique, du Swift sur la gestion des paiements et de la liquidité, des évolutions des instruments de paiement en monnaie électronique ; le traitement de 100% des opérations en monnaie nationale dans le Système de Règlement Brut en Temps Réel (RTGS) et dans la Chambre de Compensation Automatisée (ACH) ; la fourniture à la BCC du Switch monétique national le 23 octobre 2017 ; la finalisation des statuts et du plan d’affaires de la Société Monétique Interbancaire du Congo ; la réalisation du diagnostic sectoriel de la microfinance et des outils de la supervision basée sur le risque, approuvé par la BCC le 22 septembre 2016 ; la formation de 150 cadres de la Direction de Supervision des Intermédiaires Financiers de la BCC dans les domaines du contrôle interne, de l’analyse des plans d’affaires des IMFs et de la supervision sur place et sur pièces basée sur les risques; la formation de 362 personnes; agents et cadres des IFP dans les domaines de la transformation et la consolidation de l’architecture institutionnelle, de l’amélioration du positionnement et des outils de gestion, de la réorganisation du département MPME, de la croissance du financement du secteur agricole ; l’élaboration des manuels des opérations de la ligne de crédit et du guichet de refinancement de la BCC ; la mise en place d’un guichet de refinancement à la BCC ; le décaissement de la ligne de crédit à moyen et long terme à hauteur de 8.165.447 USD, à travers le FPM SA (3.000.000 USD) et la BCC (5.165.447 USD), en faveur de 811 MPME (dont 13 agricoles), par le biais de deux banques commerciales, six IMFs et deux COOPECs et enfin la mise en place des politiques sociales et environnementales dans les institutions financières bénéficiaires de la ligne de crédit de ce projet.
A travers l’implémentation de tous ces projets, la CFEF apporte une contribution exceptionnelle au développement de la République Démocratique du Congo. L’impact de ses actions au pays se font sentir dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Cette agence compte poursuivre son élan dans d’autres projets, notamment celui du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) dans 7 provinces dont elle a la charge de l’exécution des travaux.
Heshima
You may like
Non classé
Face aux défis sécuritaires persistants : l’armée congolaise en pleine mutation
Published
1 jour agoon
novembre 26, 2025By
La redaction
La République démocratique du Congo (RDC) renforce progressivement ses Forces armées (FARDC). Hausse sans cesse croissant du budget de la défense depuis 3 ans, modernisation des équipements et réformes structurelles témoignent d’une volonté politique de bâtir une armée plus professionnelle et dissuasive en vue de faire face à des défis sécuritaires persistants et à un contexte géopolitique régional toujours sous tension.
Le 18 novembre 2025 devant les députés à l’Assemblée nationale, la Première ministre Judith Suminwa a présenté le projet de loi de finances exercice 2026. Dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l’est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette : 30 % du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit depuis des lustres.
Depuis plusieurs années, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) connaissent une transformation notable, portée par une augmentation progressive des crédits alloués à la défense. Selon les autorités congolaises, cette enveloppe budgétaire vise à répondre simultanément à trois priorités : la sécurisation du territoire, la modernisation des équipements et l’amélioration des conditions de vie des militaires. L’accroissement du budget militaire s’inscrit dans un effort global de réorganisation de l’appareil sécuritaire. Une part significative des ressources est consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements : véhicules blindés, moyens de communication modernes, drones de surveillance et armements adaptés aux opérations dans des terrains difficiles, notamment dans l’est du pays. Ces investissements visent à renforcer la capacité opérationnelle des troupes face aux groupes armés et aux menaces asymétriques.
Parallèlement, la professionnalisation de l’armée constitue un autre axe majeur de cette montée en puissance. Des programmes de formation et de recyclage sont mis en place, parfois en coopération avec des partenaires étrangers, afin d’améliorer la discipline, la chaîne de commandement et la maîtrise tactique des unités. L’objectif affiché est de transformer progressivement les FARDC en une force mieux structurée, capable de mener des opérations coordonnées et efficaces.
Appui financier extérieur
Dans cette réforme de l’armée, l’Union européenne à travers le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), a décidé d’accorder une aide de 10 millions d’euros aux FARDC. Le 24 novembre 2025, le Conseil de l’Union européenne a officiellement adopté une nouvelle mesure d’assistance de 10 millions d’euros en faveur des FARDC. Cette somme est destinée à l’acquisition d’équipements militaires non létaux, adaptés aux besoins opérationnels des forces congolaises. Selon le Conseil de l’UE, il s’agira notamment de matériel pour renforcer le commandement et le contrôle, d’équipements logistiques visant à améliorer les conditions de déploiement des troupes, des infrastructures médicales, ainsi que des moyens de patrouille, notamment le long des frontières fluviales.
Il s’agit de la deuxième mesure de ce type accordée par l’UE aux FARDC : la première datée de 2023 visait à soutenir la 31ᵉ brigade de réaction rapide, basée à Kindu, dans la province du Maniema. Ce qui porte le soutien total de l’UE via la FEP à l’armée congolaise à 30 millions d’euros. Les autorités européennes expliquent que cet appui vise à renforcer la capacité des FARDC à protéger les civils et à restaurer l’autorité de l’État dans des zones fragilisées par les conflits. Les premières livraisons des matériels sont prévues avant la fin de 2026.
Un projet de réforme plus large…
Cette mutation profonde de l’armée s’inscrit dans un projet plus large qui s’étend jusqu’en 2028. Avec la loi de programmation militaire votée au Parlement, ce projet de montée en puissance des forces congolaises comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures militaires.
En assurant des réformes au sein de l’armée, le gouvernement espère récupérer des territoires occupés par des groupes rebelles, notamment dans l’Est de la RDC. « Le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passée entre les mains de l’ennemi », a déclaré la Première ministre lors de la défense du budget 2026.
Bâtir une armée en valorisant aussi l’expertise nationale
Cette dynamique de réforme s’accompagne également d’une volonté d’industrialisation locale du secteur de la défense. Les autorités évoquent la relance de certaines unités de production et de maintenance militaires, destinées à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à favoriser un savoir-faire national. A la N’sele, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, un vaste projet de construction des ateliers est en cours. Conduit par le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik du Service national, l’objectif de ce projet d’atelier est de construire des tenues militaires et policières sur place au pays. Cet atelier vise à réduire la dépendance extérieure en produisant localement des uniformes pour les FARDC et la Police nationale congolaise (PNC), avec une capacité de production de 2 000 tenues par jour soit environ 700 000 par an. Un aspect marquant est que l’atelier est géré par des anciens « kulunas », réinsérés et formés par le Service national pour devenir des « bâtisseurs de la nation ». L’atelier sera inauguré en décembre 2025.
Veiller à la qualité du soldat et de l’officier
Dans cette phase de perfectionnement, l’armée veut aussi veiller sur la qualité du soldat mais aussi de l’officier supérieur et subalterne. Lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes des FARDC, le 8 avril 2025, à l’EFO Kananga, le lieutenant-général Obed Rwibasira, commandant général des écoles militaires de l’armée, avait épinglé un manque de discipline observée chez certains militaires. Il avait profité de cette occasion pour appeler les parents à envoyer leurs meilleurs enfants au sein de l’armée. « Nous vous exhortons de donner à l’armée des bons enfants, bien aimés, bien éduqués, instruits et intelligents car l’avenir de l’armée et de notre pays a un prix à payer. », avait-il déclaré devant des parents des nouveaux officiers subalternes mais aussi des autorités politiques dont le ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita.
L’accent est également mis sur la formation des officiers supérieurs, avec la création de l’École de guerre de Kinshasa (EGK) en 2021, pour préparer l’élite militaire à assumer des responsabilités plus importantes. Les objectifs incluent l’harmonisation des programmes, l’alignement sur les doctrines militaires et le renforcement des compétences pour mieux protéger la population, comme l’indique l’évaluation du Plan de réforme de l’armée. La formation des FARDC se concentre donc sur une amélioration de la qualité grâce à des programmes diversifiés, notamment l’entraînement spécialisé dans des domaines comme les armes lourdes, les drones et le combat.
Du côté des responsables de l’armée, une sévérité s’observe depuis quelques mois. Une vingtaine d’officiers généraux et supérieurs sont aux arrêts pour diverses raisons notamment des faits « hautement répréhensibles ». Le 22 novembre, le porte-parole de l’armée, le général-major Sylvain Ekenge, avait confirmé ces interpellations sans donner plus de détails. Parmi eux, le général Franck Ntumba, chef de la Maison militaire, un service directement rattaché à la présidence. Christian Ndaywel Okura, ex-chef des renseignements militaires (ex-DEMIAP), il avait été nommé il y a environ un an chef d’état-major de la force terrestre. Il y a aussi le général d’armée Christian Tshiwewe, ancien chef d’état-major des FARDC, il était, jusqu’à son arrestation, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Ces officiers, qui ne sont ni à la prison de Makala ni à Ndolo, sont tous détenus dans des bonnes conditions, affirme Paul Nsapu, président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). « Nous avons même échangé. Ils sont en bonne santé, les médecins les visitent, chacun avec ses petits problèmes, ses petits bobos de santé. Et nous avons même blagué : ils sont tous contents parce que nos Léopards ont gagné, ils ont suivi tous le dernier match contre le Nigeria. Ils étaient en joie, ils ont même sautillé. Ils nous ont dit comment ils étaient très contents et fiers. C’est pour dire que le droit au loisir, à la lecture, ils ont dit qu’ils sont dans de très bonnes conditions. », a-t-il ajouté le 22 novembre 2025.
Le budget des FARDC pourrait dépasser celui de l’Angola
Dans un continent où la paix s’éloigne de plus en plus, la majorité des armées africaines augmentent leur budget de défense. C’est le cas de l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Angola, la RDC et d’autres pays qui ont des défis sécuritaires liés notamment au terrorisme tel que le Nigeria. Si le gouvernement algérien a octroyé à son armée un budget annuel de 25 milliards de dollars en 2025, la RDC veut aussi casser sa tirelire pour moderniser son outil de défense. Composée d’une armée moderne, comprenant l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, l’armée algérienne est aussi classée première en Afrique en terme d’indice de puissance. Si en 2025 la RDC a octroyé sur le papier 800 millions de dollars à son armée, ce budget a été dépassé lors des dépenses militaires. En 2026, le budget des FARDC va exploser, passant de 800 millions à près de 8 milliards de dollars, soit le tiers du budget national chiffré à 25 milliards de dollars.
L’Angola, classé 8ème en Afrique (devant la RDC) en terme de budget de la défense, pourrait se voir dépasser par le pays de Félix Tshisekedi. L’Angola est réputé pour ses importantes forces terrestres et sa puissante armée de l’air. En 2025, le budget militaire du pays était de 2,1 milliards de dollars. Mais avec environ 8 milliards USD de défense prévus pour la RDC, le pays de Félix Tshisekedi pourrait se placer loin devant l’Angola et même l’Egypte qui a alloué un budget militaire de 5,88 milliards de dollars à ses forces armées en 2025.
Si les progrès sont salués par une partie de l’opinion, des défis demeurent. La transparence dans la gestion des fonds, la lutte contre la corruption et l’amélioration continue de la gouvernance sécuritaire restent des enjeux cruciaux pour pérenniser ces réformes.
Heshima
Non classé
RDC : la DGI multiplie les matinées fiscales pour vulgariser la facture normalisée
Published
1 semaine agoon
novembre 20, 2025By
La redaction
À partir du 1er décembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) de la République démocratique du Congo rend obligatoire l’émission et l’exigence d’une facture « normalisée » via un dispositif électronique fiscal (DEF). Cette réforme, initiée par le gouvernement à travers le ministre des Finances, Doudou Fwamba, vise à mieux tracer les opérations commerciales, à lutter contre la fraude à la TVA et à améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Cependant, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) demande à la DGI un nouveau report de l’implémentation de cette réforme fiscale, arguant de difficultés techniques pour les entreprises concernées.
Prévue pour entrer en vigueur le 1er décembre, la facture normalisée continue de susciter des discussions intenses entre la DGI et le patronat congolais. Lors d’une matinée fiscale organisée le 18 novembre 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa, Thierry Ngoy Kasumba, administrateur délégué de la FEC, a sollicité un nouveau report pour permettre de corriger certains problèmes techniques. Selon lui, plusieurs obstacles complexifient l’application de cette réforme, notamment des dysfonctionnements tels que le blocage de la plateforme lors d’accès simultanés de plusieurs entreprises, des failles de sécurité des comptes en cas d’accès non autorisés et l’absence d’un système multiutilisateurs. Ces lacunes, explique-t-il, pénalisent particulièrement les sociétés disposant de plusieurs points de vente.
La DGI encourage l’accompagnement des entreprises
Face à ces défis, la DGI encourage les entreprises à participer aux sessions d’accompagnement en ligne organisées chaque jour impair et à utiliser le dispositif d’assistance mis en place pour faciliter la transition entre l’ancien système et la nouvelle réforme fiscale. Représentant la DGI lors de cette matinée fiscale, Julie Bilonda a rappelé que cette réforme est cruciale car elle permettra de lutter contre la fraude fiscale, de renforcer la transparence des transactions commerciales et de moderniser la collecte de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Une réforme structurante pour la fiscalité congolaise
En procédant à la modernisation de son système fiscal, la RDC franchit une étape décisive : la facture normalisée devient obligatoire à compter du 1er décembre pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, selon un communiqué officiel de la DGI. Si le délai n’est pas repoussé, la RDC entrera dans une nouvelle ère de sa gestion fiscale. Le ministre Fwamba a défendu cette réforme comme un levier essentiel de transparence. Lors d’une réunion de travail avec la DGI et le comité technique chargé de piloter le projet, il a réaffirmé que la généralisation de la facture normalisée avait été confirmée à plusieurs reprises, notamment le 23 juin 2025. L’objectif central demeure : suivre en temps réel les montants collectés et déductibles de TVA, identifier les écarts de fraude, et réduire systématiquement les échappements fiscaux.
La facture normalisée favorise également une meilleure équité entre contribuables. La réforme vise l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 80 millions de francs congolais (CDF), soit environ 37 000 dollars américains (USD).
Dispositifs électroniques sécurisés et conformes
Pour émettre ces factures, les entreprises devront s’équiper de Dispositifs Électroniques Fiscaux (DEF) ou adapter leurs systèmes existants. Ces dispositifs permettent une transmission instantanée des données à la DGI et garantissent l’authenticité, l’intégrité et la traçabilité complètes des informations de TVA. Pour les entreprises disposant déjà d’un système de facturation, des « modules de contrôle » compatibles seront fournis pour assurer leur mise à niveau. Par ailleurs, la DGI mettra gratuitement à disposition certains DEF ou leurs versions dématérialisées pour faciliter la transition vers ce nouveau régime.
Sanctions pour non-conformité et incitations citoyennes
La DGI a adressé un avertissement clair : toute entreprise demeurant non conforme après la période de transition perdra le droit de déduire la TVA, ce qui constitue une sanction financière majeure susceptible d’affecter sa compétitivité. En parallèle, l’État souhaite encourager les consommateurs à exiger systématiquement une facture normalisée lors de leurs achats. Le ministre Fwamba a évoqué des incitations attractives, telles que des tombolas dotées de maisons ou de véhicules, destinées à valoriser cette pratique citoyenne et à accroître l’engagement des consommateurs.
Réserves et préoccupations du patronat
Cependant, tous les acteurs ne partagent pas l’optimisme officiel. La Fédération des Entreprises du Congo avait déjà recommandé le report du lancement initialement prévu le 1er mars 2025, estimant que plusieurs préalables n’étaient pas encore remplis : homologation des logiciels de facturation, déploiement complet des DEF sur l’ensemble du territoire, formation des utilisateurs en province, etc. De nombreuses entreprises craignent des difficultés d’adaptation opérationnelle ou des surcoûts cachés, malgré les promesses d’accompagnement technique de la DGI.
Calendrier d’implémentation et perspectives futures
Selon le ministre Fwamba, la phase de généralisation marque un tournant décisif, succédant à une phase pilote jugée concluante. En parallèle, le gouvernement élabore déjà un cadre pour une facture numérique (e-facture) destinée à des secteurs spécifiques comme les télécommunications ou les institutions bancaires, qui bénéficieront d’un dispositif numérique plus flexible. Le data-center fiscal est désormais opérationnel, et le système SYGDEF (système de gestion des données fiscales) est en cours d’interconnexion avec l’ensemble des DEF.
En imposant la facture normalisée, la RDC engage un pari stratégique ambitieux : elle entend renforcer sa souveraineté budgétaire en maximisant les recettes de TVA, tout en modernisant son administration fiscale. Si cette réforme s’affirme indéniablement comme une avancée vers une plus grande transparence des transactions commerciales, son succès dépendra fortement de la capacité réelle des entreprises à s’adapter rapidement et de la volonté des citoyens à exiger systématiquement leur facture. Le pari est d’envergure, mais il pourrait transformer profondément l’écosystème fiscal congolais dans les années à venir.
Heshima
Non classé
RDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA
Published
2 semaines agoon
novembre 10, 2025By
La redaction
La Direction générale des impôts (DGI) a, dans un communiqué signé par son directeur général, Barnabé Muakadi Muamba, rappelé aux assujettis à l’Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR), à l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés (IERE) ainsi qu’à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que la date limite de déclaration pour le mois d’octobre 2025 est fixée au 15 novembre 2025.
Étant donné que cette échéance tombe un samedi, la DGI invite les contribuables concernés à souscrire leurs déclarations au plus tard le lundi 17 novembre 2025.
Lisez, en intégralité, le communiqué de cette régie fiscale.
Trending
-

 International2 semaines ago
International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux
-

 Politique3 semaines ago
Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?
-
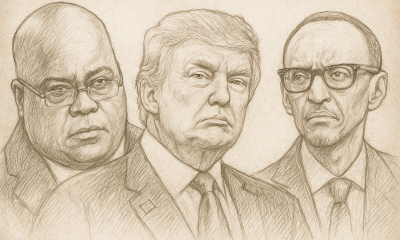
 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?
-
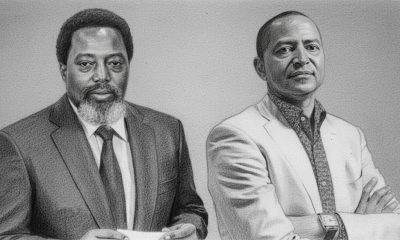
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?
-

 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA
-

 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?
-

 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha
-

 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines agoNeutralisation des FDLR en RDC : quels résultats en 30 ans ?





























































