La République démocratique du Congo (RDC) renforce progressivement ses Forces armées (FARDC). Hausse sans cesse croissant du budget de la défense depuis 3 ans, modernisation des équipements et réformes structurelles témoignent d’une volonté politique de bâtir une armée plus professionnelle et dissuasive en vue de faire face à des défis sécuritaires persistants et à un contexte géopolitique régional toujours sous tension.
Le 18 novembre 2025 devant les députés à l’Assemblée nationale, la Première ministre Judith Suminwa a présenté le projet de loi de finances exercice 2026. Dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l’est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette : 30 % du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit depuis des lustres.
Depuis plusieurs années, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) connaissent une transformation notable, portée par une augmentation progressive des crédits alloués à la défense. Selon les autorités congolaises, cette enveloppe budgétaire vise à répondre simultanément à trois priorités : la sécurisation du territoire, la modernisation des équipements et l’amélioration des conditions de vie des militaires. L’accroissement du budget militaire s’inscrit dans un effort global de réorganisation de l’appareil sécuritaire. Une part significative des ressources est consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements : véhicules blindés, moyens de communication modernes, drones de surveillance et armements adaptés aux opérations dans des terrains difficiles, notamment dans l’est du pays. Ces investissements visent à renforcer la capacité opérationnelle des troupes face aux groupes armés et aux menaces asymétriques.
Parallèlement, la professionnalisation de l’armée constitue un autre axe majeur de cette montée en puissance. Des programmes de formation et de recyclage sont mis en place, parfois en coopération avec des partenaires étrangers, afin d’améliorer la discipline, la chaîne de commandement et la maîtrise tactique des unités. L’objectif affiché est de transformer progressivement les FARDC en une force mieux structurée, capable de mener des opérations coordonnées et efficaces.
Appui financier extérieur
Dans cette réforme de l’armée, l’Union européenne à travers le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), a décidé d’accorder une aide de 10 millions d’euros aux FARDC. Le 24 novembre 2025, le Conseil de l’Union européenne a officiellement adopté une nouvelle mesure d’assistance de 10 millions d’euros en faveur des FARDC. Cette somme est destinée à l’acquisition d’équipements militaires non létaux, adaptés aux besoins opérationnels des forces congolaises. Selon le Conseil de l’UE, il s’agira notamment de matériel pour renforcer le commandement et le contrôle, d’équipements logistiques visant à améliorer les conditions de déploiement des troupes, des infrastructures médicales, ainsi que des moyens de patrouille, notamment le long des frontières fluviales.
Il s’agit de la deuxième mesure de ce type accordée par l’UE aux FARDC : la première datée de 2023 visait à soutenir la 31ᵉ brigade de réaction rapide, basée à Kindu, dans la province du Maniema. Ce qui porte le soutien total de l’UE via la FEP à l’armée congolaise à 30 millions d’euros. Les autorités européennes expliquent que cet appui vise à renforcer la capacité des FARDC à protéger les civils et à restaurer l’autorité de l’État dans des zones fragilisées par les conflits. Les premières livraisons des matériels sont prévues avant la fin de 2026.
Un projet de réforme plus large…
Cette mutation profonde de l’armée s’inscrit dans un projet plus large qui s’étend jusqu’en 2028. Avec la loi de programmation militaire votée au Parlement, ce projet de montée en puissance des forces congolaises comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures militaires.
En assurant des réformes au sein de l’armée, le gouvernement espère récupérer des territoires occupés par des groupes rebelles, notamment dans l’Est de la RDC. « Le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passée entre les mains de l’ennemi », a déclaré la Première ministre lors de la défense du budget 2026.
Bâtir une armée en valorisant aussi l’expertise nationale
Cette dynamique de réforme s’accompagne également d’une volonté d’industrialisation locale du secteur de la défense. Les autorités évoquent la relance de certaines unités de production et de maintenance militaires, destinées à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à favoriser un savoir-faire national. A la N’sele, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, un vaste projet de construction des ateliers est en cours. Conduit par le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik du Service national, l’objectif de ce projet d’atelier est de construire des tenues militaires et policières sur place au pays. Cet atelier vise à réduire la dépendance extérieure en produisant localement des uniformes pour les FARDC et la Police nationale congolaise (PNC), avec une capacité de production de 2 000 tenues par jour soit environ 700 000 par an. Un aspect marquant est que l’atelier est géré par des anciens « kulunas », réinsérés et formés par le Service national pour devenir des « bâtisseurs de la nation ». L’atelier sera inauguré en décembre 2025.
Veiller à la qualité du soldat et de l’officier
Dans cette phase de perfectionnement, l’armée veut aussi veiller sur la qualité du soldat mais aussi de l’officier supérieur et subalterne. Lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes des FARDC, le 8 avril 2025, à l’EFO Kananga, le lieutenant-général Obed Rwibasira, commandant général des écoles militaires de l’armée, avait épinglé un manque de discipline observée chez certains militaires. Il avait profité de cette occasion pour appeler les parents à envoyer leurs meilleurs enfants au sein de l’armée. « Nous vous exhortons de donner à l’armée des bons enfants, bien aimés, bien éduqués, instruits et intelligents car l’avenir de l’armée et de notre pays a un prix à payer. », avait-il déclaré devant des parents des nouveaux officiers subalternes mais aussi des autorités politiques dont le ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita.
L’accent est également mis sur la formation des officiers supérieurs, avec la création de l’École de guerre de Kinshasa (EGK) en 2021, pour préparer l’élite militaire à assumer des responsabilités plus importantes. Les objectifs incluent l’harmonisation des programmes, l’alignement sur les doctrines militaires et le renforcement des compétences pour mieux protéger la population, comme l’indique l’évaluation du Plan de réforme de l’armée. La formation des FARDC se concentre donc sur une amélioration de la qualité grâce à des programmes diversifiés, notamment l’entraînement spécialisé dans des domaines comme les armes lourdes, les drones et le combat.
Du côté des responsables de l’armée, une sévérité s’observe depuis quelques mois. Une vingtaine d’officiers généraux et supérieurs sont aux arrêts pour diverses raisons notamment des faits « hautement répréhensibles ». Le 22 novembre, le porte-parole de l’armée, le général-major Sylvain Ekenge, avait confirmé ces interpellations sans donner plus de détails. Parmi eux, le général Franck Ntumba, chef de la Maison militaire, un service directement rattaché à la présidence. Christian Ndaywel Okura, ex-chef des renseignements militaires (ex-DEMIAP), il avait été nommé il y a environ un an chef d’état-major de la force terrestre. Il y a aussi le général d’armée Christian Tshiwewe, ancien chef d’état-major des FARDC, il était, jusqu’à son arrestation, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Ces officiers, qui ne sont ni à la prison de Makala ni à Ndolo, sont tous détenus dans des bonnes conditions, affirme Paul Nsapu, président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). « Nous avons même échangé. Ils sont en bonne santé, les médecins les visitent, chacun avec ses petits problèmes, ses petits bobos de santé. Et nous avons même blagué : ils sont tous contents parce que nos Léopards ont gagné, ils ont suivi tous le dernier match contre le Nigeria. Ils étaient en joie, ils ont même sautillé. Ils nous ont dit comment ils étaient très contents et fiers. C’est pour dire que le droit au loisir, à la lecture, ils ont dit qu’ils sont dans de très bonnes conditions. », a-t-il ajouté le 22 novembre 2025.
Le budget des FARDC pourrait dépasser celui de l’Angola
Dans un continent où la paix s’éloigne de plus en plus, la majorité des armées africaines augmentent leur budget de défense. C’est le cas de l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Angola, la RDC et d’autres pays qui ont des défis sécuritaires liés notamment au terrorisme tel que le Nigeria. Si le gouvernement algérien a octroyé à son armée un budget annuel de 25 milliards de dollars en 2025, la RDC veut aussi casser sa tirelire pour moderniser son outil de défense. Composée d’une armée moderne, comprenant l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, l’armée algérienne est aussi classée première en Afrique en terme d’indice de puissance. Si en 2025 la RDC a octroyé sur le papier 800 millions de dollars à son armée, ce budget a été dépassé lors des dépenses militaires. En 2026, le budget des FARDC va exploser, passant de 800 millions à près de 8 milliards de dollars, soit le tiers du budget national chiffré à 25 milliards de dollars.
L’Angola, classé 8ème en Afrique (devant la RDC) en terme de budget de la défense, pourrait se voir dépasser par le pays de Félix Tshisekedi. L’Angola est réputé pour ses importantes forces terrestres et sa puissante armée de l’air. En 2025, le budget militaire du pays était de 2,1 milliards de dollars. Mais avec environ 8 milliards USD de défense prévus pour la RDC, le pays de Félix Tshisekedi pourrait se placer loin devant l’Angola et même l’Egypte qui a alloué un budget militaire de 5,88 milliards de dollars à ses forces armées en 2025.
Si les progrès sont salués par une partie de l’opinion, des défis demeurent. La transparence dans la gestion des fonds, la lutte contre la corruption et l’amélioration continue de la gouvernance sécuritaire restent des enjeux cruciaux pour pérenniser ces réformes.
Heshima


 International2 semaines ago
International2 semaines ago
 Politique3 semaines ago
Politique3 semaines ago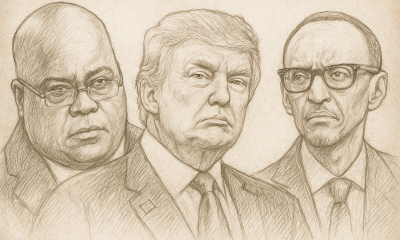
 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines ago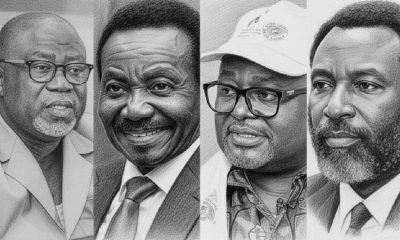
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago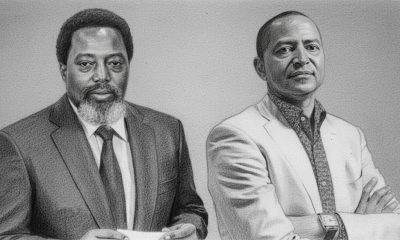
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago
 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine ago































































