Entre routes récemment tracées, premier Mall de Kolwezi, université moderne et instituts supérieurs en construction, la province du Lualaba façonne son avenir à coup de béton et d’ambition. Loin de se reposer après une série d’inaugurations en juin dernier, la gouverneure Fifi Masuka a immédiatement entamé l’inspection des chantiers en cours. Dans la foulée, le plus grand barreau de l’espace Katanga a été inauguré.
Alors que l’opinion congolaise admire encore les ouvrages récemment inaugurés par le président de la République Félix Tshisekedi, d’autres structures imposantes sortent déjà de terre au Lualaba. Pas moins de quatorze chantiers majeurs ont été visités en juillet par Fifi Masuka et son adjoint, Clément Mufundji.
Université de Kolwezi rénovée, centre commercial futuriste, Palais de justice militaire, routes élargies, zones industrielles en pleine activité : le Lualaba poursuit son développement à un rythme soutenu.
Après un Village, bientôt un Palais des congrès
Après la construction et l’inauguration du Village des congrès, la gouverneure du Lualaba s’apprête à finaliser un autre chantier de prestige : le Palais des congrès. Désormais, la province ne manquera plus d’infrastructures pour accueillir de grands événements, notamment des conférences internationales.
Le futur Palais comptera un amphithéâtre de 200 places et pourra, dans son ensemble, recevoir jusqu’à 1 000 personnes, selon un ingénieur de ZS Africa Solutions Sarl, entreprise en charge des travaux. Cette nouvelle infrastructure viendra s’ajouter au Village des congrès déjà inauguré.
« Ce complexe d’envergure de 6 305 m² positionne le Lualaba comme un centre des conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques, économiques et technologiques. Il comprend une salle de congrès de 15 000 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion, un modèle de 6 chambres et 2 appartements. Ces ouvrages sont le fruit du silence actif d’une servante dédiée à sa mission », avait déclaré Fifi Masuka lors de l’inauguration du Village.
Université de Kolwezi modernisée
La transformation du Lualaba est en marche. Le 14 juillet 2025, la gouverneure Fifi Masuka a sillonné la ville de Kolwezi pour inspecter plusieurs chantiers stratégiques. À l’Université de Kolwezi, elle a suivi de près l’avancement d’un vaste projet de modernisation : des bâtiments imposants pour plusieurs facultés comprenant 20 auditoires de 200 places chacun, un bâtiment administratif R+3 avec 22 bureaux, ainsi que quatre homes universitaires (deux pour hommes et deux pour femmes). À terme, l’université pourra accueillir près de 9 000 étudiants. À proximité, une clinique universitaire de 100 lits prend forme, dotée d’un bloc opératoire, d’un laboratoire et de services de médecine interne et externe. Objectif : limiter les coûteuses évacuations sanitaires vers l’étranger.
La gouverneure a également visité les travaux de modernisation de l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA/Kolwezi), situé dans le quartier Golf-ISTM, ainsi que ceux de l’Institut supérieur pédagogique (ISP/Kolwezi). Concernant l’enseignement de base, plusieurs écoles sont en chantier, dont le Lycée Umoja, actuellement modernisé, et un internat aux standards internationaux avec 50 logements sociaux. « Nous sommes très satisfaits de l’évolution des travaux », a déclaré Fifi Masuka à l’issue de cette ronde d’inspection.
Mall de Kolwezi, un bijou sans précédent
Dans le quartier Joli Site, à Dilala, un ouvrage attire déjà les regards avant même son inauguration : le premier Shopping Mall de Kolwezi. Les travaux ont bien avancé, fruit d’une initiative du gouvernement provincial, conduite par la gouverneure Fifi Masuka, en ligne avec la vision du chef de l’État. Accompagnée de son adjoint, Clément Mufundji, elle a récemment inspecté le chantier, qui figure parmi les infrastructures appelées à être inaugurées prochainement.
Ce centre commercial, une première dans la ville, sera doté notamment d’escalators. « C’est un joyau architectural. La ville n’avait jamais connu de telles infrastructures. C’est un bijou sans précédent », témoigne Albert Mutshail, habitant de Kolwezi. Connue comme la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi poursuit son expansion. Ce projet entend répondre aux besoins croissants de la population en matière de shopping et de services.
Un zone économique spéciale
À quelques kilomètres de là, la zone économique spéciale de Fungurume prend forme. Sous un soleil doux, des hangars industriels émergent du sol. C’est dans cet espace que seront regroupées les unités de transformation minière et les entreprises logistiques.
L’ambition : bâtir un écosystème capable de capter une plus grande part de la chaîne de valeur du secteur extractif. Pour les miniers, cette zone doit accueillir les sociétés produisant des intrants nécessaires aux exploitations, favorisant ainsi la création d’un marché institutionnel. Une étape clé pour assurer l’adéquation entre les besoins de la RDC et la sous-traitance dans ce domaine.
L’évolution de plusieurs chantiers saluée
Lors de ses visites, Fifi Masuka Saïni a salué l’avancée de plusieurs chantiers et félicité les entreprises de construction impliquées dans la transformation du Lualaba. Son cortège a notamment inspecté le chantier du Palais de justice militaire, encore en construction, ainsi que ceux des résidences officielles du gouverneur et de son adjoint. Les travaux des nouveaux bureaux de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) figurent également parmi les sites visités.
À Lualaba-Gare, dans le territoire de Mutshatsha, un chantier de 550 logements sociaux est déjà bien avancé, symbole d’un développement prenant en compte les besoins en habitat. À Kolwezi, un orphelinat baptisé « Maman Denise Nyakeru » est en cours de construction, accompagné d’une école destinée aux enfants nécessiteux, qui bénéficiera d’un programme inédit au pays.
« Aux premières heures de ce 14 juillet, nous avons lancé une tournée d’inspection de quatorze chantiers structurants à Kolwezi. Du Shopping Mall moderne aux amphithéâtres de l’ISTA et de l’ISP, en passant par le futur Palais de justice militaire, nous veillons à ce que chaque ouvrage reflète la grandeur du Lualaba et matérialise la vision du président Félix Tshisekedi : un Congo fort, prospère et respectueux de l’État de droit », a-t-elle déclaré au terme de cette tournée.
Un grand barreau inauguré à Kolwezi
Le 16 août 2025, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a inauguré à Kolwezi la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Après la coupure du ruban symbolique, elle a procédé à une visite guidée des différents compartiments du bâtiment.
« Nous venons d’inaugurer la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Cet édifice pionnier, fruit d’un partenariat solide entre notre gouvernement et le Barreau, incarne l’État de droit voulu par le président Félix Tshisekedi. Nous exhortons nos avocats à en faire un rempart d’équité et de justice accessible à toutes les couches sociales », a déclaré la gouverneure.
Ce nouvel édifice accueillera plus de 1.000 avocats et stagiaires inscrits au tableau du Barreau du Lualaba. Le bâtonnier du Lualaba, Laurent Mbako, ainsi que le bâtonnier national, Michel Shebele, ont souligné son importance pour le travail quotidien des avocats, appelant leurs pairs à en faire un instrument au service de la justice et de la population. Ils ont également remercié la gouverneure pour son soutien financier à la réalisation du projet. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Telésphore Nduba, a salué l’engagement constant de Fifi Masuka dans le développement des infrastructures judiciaires, en cohérence avec la vision politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Diplôme de « bâtisseur » décerné à Fifi Masuka
Face à la transformation que connaît la province du Lualaba sous l’impulsion du président Félix Tshisekedi, la gouverneure Fifi Masuka a été honorée par l’Assemblée provinciale. Le 1er juillet, l’organe de contrôle de l’exécutif lui a décerné le titre de « Bâtisseur du Lualaba ». Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée provinciale, Jean-Marie Kaseya Tshingambo, a salué la « bravoure » de la gouverneure et assuré l’accompagnement de son institution dans son ambition de doter la province d’infrastructures modèles.
En décembre 2024, Fifi Masuka avait déjà reçu le prix « Mama Muilu » pour sa politique ambitieuse en matière d’infrastructures. Ce prix lui a été décerné pour la construction d’un échangeur à Kolwezi — faisant du Lualaba la deuxième province du pays, après Kinshasa, à en disposer — ainsi que la modernisation de l’aéroport et de plusieurs édifices publics.
Sous son mandat, le Lualaba connaît une mutation profonde. Sa stratégie repose sur une approche holistique intégrant mobilité, éducation, énergie, urbanisation et dignité citoyenne. Avec un plan quinquennal dédié aux infrastructures, représentant 76 % du budget provincial (environ 2,4 milliards USD), la gouverneure trace une trajectoire de développement durable et positionne le Lualaba comme un modèle régional.
Sur le terrain, les défis demeurent, notamment dans les territoires, mais une certitude s’impose : le visage du Lualaba change, porté par les truelles, les camions-bennes et une volonté politique affirmée.
Heshima

 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago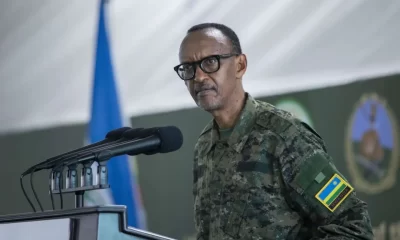
 International3 semaines ago
International3 semaines ago
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago
 Economie3 semaines ago
Economie3 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation4 jours ago
Nation4 jours ago
 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine ago
































































