Union Africaine
C’est en 1963, au lendemain des premières indépendances des Etats africains autrefois colonies occidentales, qu’est créée l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Alors que deux tendances, celle de Nkuameh Krumah, Président du Ghana et celle de Léopold Sédar Senghor du Sénégal, se disputent la paternité de l’OUA, les avis tendent à converger autour de l’ancien empereur éthiopien Hailé Sélassié. Dans un premier temps trente-deux pays seulement signent la charte créant l’OUA faisant d’elle une organisation essentiellement de développement et non d’intégration. Des décennies durant l’Organisation de l’Unité Africaine a axé sa politique sur la lutte contre le colonialisme et n’intervenait jamais dans les affaires internes des pays membres, laissant ces derniers sombrer dans la dictature et les coups d’Etat.
Elle a présenté des limites dans la gestion et la prévention des conflits, ne basant son fonctionnement que sur des dossiers purement administratifs tels que la révision des statuts. Les panafricanistes reprochent à l’OUA une faible implication diplomatique quant à l’emprisonnement de Nelson Mandela ou encore l’assassinat de Thomas Sankara mais aussi un laisser-faire dans l’instabilité des pays de l’Afrique de l’Ouest à l’exemple du Ghana, du Nigéria, de la Sierra Leone où se sont succédé putsch et assassinats des chefs d’Etat.
Devant cette nonchalance de l’instance africaine, le président libyen Mouammar Kadhafi fort des largesses économiques que lui offre la manne pétrolière de son pays, commence à torpiller l’OUA. Face à l’incapacité de l’organisation à soutenir financièrement des pays en difficulté, Kadhafi offre de l’aide financière aux pays vulnérables qui se rallient progressivement à lui. En 1983, le Maroc déçu de la reconnaissance par l’OUA du Sahara occidental qu’il annexait depuis des décennies décide de quitter l’OUA, une fragilisation de plus.
Mouammar Kadhafi remportera finalement son combat au début des années 2000 lorsqu’à Durban en Afrique du Sud, de nombreux présidents africains lèvent l’option de tuer l’Organisation de l’Unité Africaine. La finalité n’est pas celle de tuer pour tuer, mais d’engendrer à partir des restes de l’ancienne organisation, une instance africaine intégrant le plus grand nombre des membres et qui offre davantage de possibilités politiques, économiques et financières pour un développement intégré du continent africain.
C’est la naissance de l’Union Africaine (UA) que les dirigeants africains veulent plus adaptée aux réalités africaines de l’heure. Elle conserve son siège à Addis-Abeba, cependant elle change dans son mode de fonctionnement en optant pour une structure quelque peu calquée sur l’Union Européenne.
Organes et Fonctionnement de l’UA
De sa création en 2002 à ce jour, l’UA est composée des organes ci-après :
– La conférence de l’union ;
– Le conseil exécutif ;
– Le parlement panafricain ;
– La cour de justice ;
– La commission ;
– Le comité des représentants permanents ;
– Les comités techniques spécialisés ;
– Les institutions financières.
La Conférence de l’Union est composée des chefs d’Etats et des gouvernements ou leurs représentants dûment accrédités. Elle est l’organe suprême de l’union et se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d’un État membre et sur approbation des deux tiers des membres, elle se réunit en session extraordinaire.
La présidence de la conférence est assurée pendant un an par un chef d’état et de gouvernement élu, après consultation entre les États membres. Elle poursuit comme objectifs :
1. Examiner les demandes d’adhésion à l’union ;
2. Créer tout organe de l’union ;
3. Assurer le contrôlée de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’union et veiller à leur application par tous les États membres ;
4. Adopter le budget de l’union ;
5. Donner des directives au conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et d’autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix ;
6. Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la cour de justice ;
7. Nommer le président, le(s) vice-Président(s) et les commissaires de la commission et, déterminer leurs fonctions et leurs mandats.
Le Conseil Exécutif est composé des ministres des Affaires étrangères ou de tout autre ministre ou autorité désigné(e) par les gouvernements des Etats membres. Il se réunit deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande d’un État membre, sous réserve de l’approbation des deux tiers de tous les membres. Son quorum est de deux tiers (2/3) sauf pour les décisions de procédure qui sont prises à la majorité simple.
Le Conseil Exécutif adopte son règlement d’ordre intérieur et décide des politiques dans les domaines d’intérêts communs pour les États membres, notamment dans les domaines de commerce extérieur, énergie, industrie et ressources minérales, alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêt, protection de l’environnement, action humanitaire et réaction de secours en cas de catastrophe, transport et communication, assurances, éducation, culture et santé, mise en œuvre des ressources humaines, science et technologie, nationalité, résidences de ressortissants étrangers et questions d’immigrations, sécurité sociale et élaboration des politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de la politique en faveur des personnes handicapées, institutions d’un système de médaille et de prix africains.
Le Parlement Panafricain a été institué dans le but d’assurer la pleine participation des peuples d’Afrique au développement et l’intégration économique. Sa complexité est détaillée à l’article 17 de l’acte constitutif de l’Union Africaine.
La composition, les attributions, l’organisation et les pouvoirs de la Cour de justice sont repris à l’article 18 de l’acte constitutif de l’union.
La Commission de l’Union Africaine est, pour ainsi dire, le moteur de l’Union Africaine. Elle comprend un président, un vice-président, huit commissaires chargés de portefeuilles : Paix et sécurité, affaires politiques, affaires sociales, développement rural, infrastructure, énergie et transport, ressources humaines et recherche scientifique. Les commissaires sont les premiers responsables élus pour quatre ans à la tête du département qui compte environ quatre cents employés, dont des directeurs, des chefs de division, des fonctionnaires, des personnels de soutien.
Le Comité des Représentants Permanents est composé des représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres. Ce comité est responsable de la préparation des travaux du conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil exécutif. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire. Les comités techniques spécialisés font l’objet de l’article 14 de l’acte constitutif. Ces comités sont les suivants :
– Le comité chargé des questions d’économies rurales et agricoles ;
– Le comité chargé des questions commerciales, douanières et d’immigration ;
– Le comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ;
– Le comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;
– Le comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;
– Le comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.
Le Conseil Economique et Social qui est un organe consultatif, est composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de l’union. Ses attributions, pouvoirs, la composition et l’organisation sont déterminés par la Conférence de l’union. L’Union Africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans les protocoles y afférents, une de ces institutions est la Banque Africaine de Développement.
La Banque Africaine de Développement (BAD)
Créée en 1964 presque dans la foulée de l’Organisation de l’Unité Africaine, la BAD est une institution financière de l’Union Africaine qui a pour objet de faire reculer la pauvreté sévissant au sein des pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. Elle vit des cotisations des pays membres qu’elle redistribue selon les cas aux pays dans le besoin. En résumé, elle mobilise des ressources pour la promotion de l’investissement dans ces pays membres, elle leur fournit une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre. Cette mission multidimensionnelle de la BAD se fait en harmonie avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui consistent à améliorer la qualité de vie des citoyens du monde allant de l’élimination de la pauvreté, de la faim, à réduire les inégalités sociales, à lutter contre les changements climatiques, etc.
Selon le besoin, le siège de cette Institution peut se déplacer d’un pays pour un autre. Ce fut le cas lorsque la Banque Africaine de Développement a établi son siège à Tunis en Tunisie avant de faire son come back à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aux côtés des institutions inhérentes à l’Union Africaine, il existe de nombreuses autres organisations régionales telles que la CEDEAO, la SADC, la CEEAC qui tentent de procéder à une organisation basée sur la proximité géographique, linguistique et économique des Etats africains.
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Créée le 28 mai 1975, la CEDEAO est une organisation qui se concentre sur la partie ouest de l’Afrique, c’est la principale structure intergouvernementale destinée à coordonner les actions des pays de cette partie de l’Afrique. La CEDEAO tient son siège à Abuja au Nigéria. Elle compte à ce jour, quinze membres.
Son but principal est de promouvoir la coopération et l’intégration avec l’objectif de créer une union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest. Des sources de cette instance ouest-africaine ont annoncé en 2017 que le Produit intérieur brut (PIB) global des Etats membres de la CEDEAO s’élevait à 565 milliards de dollars américains.
La Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC)
Seize pays de l’Afrique Australe et de l’Océan indien forment cette organisation, il s’agit de l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la RDC, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores.
Elle voit le jour en 1980, sous l’appellation de la Conférence de coordination pour le développement de l’Afrique Australe, de la volonté de neuf pays membres (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) de promouvoir une entente économique. Ce n’est qu’en 1992 que la Conférence cède la place à la Communauté de Développement dont le siège reste à Gaborone au Botswana.
Les six autres pays, à savoir la RDC, l’Afrique du Sud, Madagascar, les Seychelles, les Comores et Maurice signent leurs entrées progressivement et en fonction des changements sociopolitiques majeurs dans leurs sociétés. La SADC est composée de quelques institutions à savoir un organe pour la politique, la défense et la sécurité ; le Conseil des Ministres qui supervise et veille au bon fonctionnement de la Communauté ; le Comité intégré des Ministres, le Secrétariat qui est l’organe d’harmonisation et de pilotage stratégique ; les Comités nationaux de la SADC.
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC)
Située à Libreville au Gabon depuis le 18 octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale créée en vue du développement économique, social et culturel de l’Afrique Centrale. En toile de fond, les pays membres pensaient par cette organisation régionale pouvait créer un Marché Commun. Avec à son actif onze pays membres, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique l’Angola, le Congo, la RD Congo, la Guinée Equatoriale, le Tchad, Sao Tomé et Principe, le Burundi et le Rwanda, la CEEAC affiche un PIB de 523 milliards de dollars américains. De fil en aiguille, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale a développé sa vision cherchant désormais une coopération harmonieuse et un développement dynamique, équilibré dans tous les domaines de la vie en vue de réaliser l’autonomie collective et élever le niveau de vie des populations.
HESHIMA
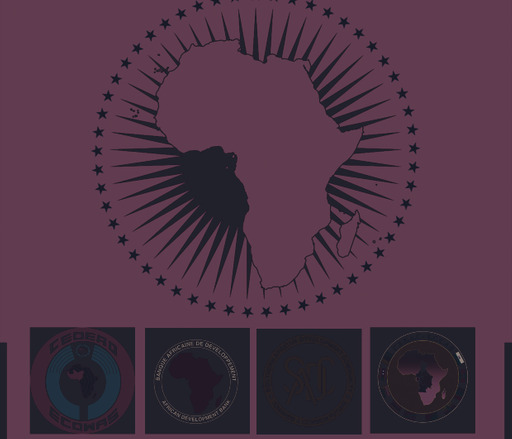

 International2 semaines ago
International2 semaines ago
 Politique3 semaines ago
Politique3 semaines ago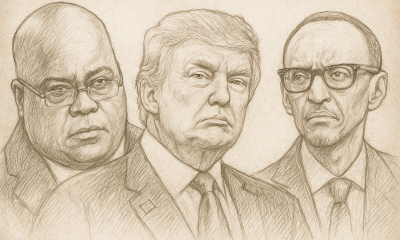
 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines ago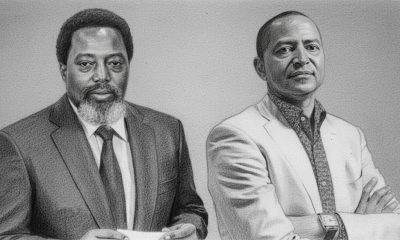
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago
 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine ago
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago































































