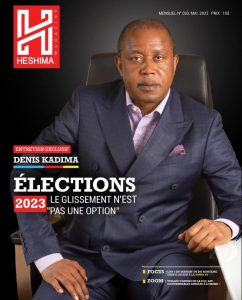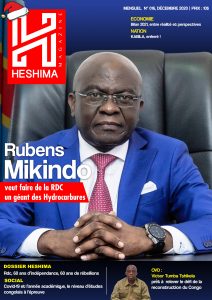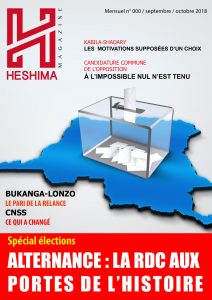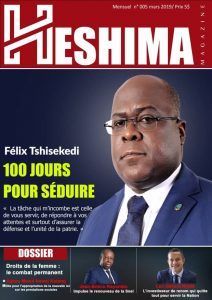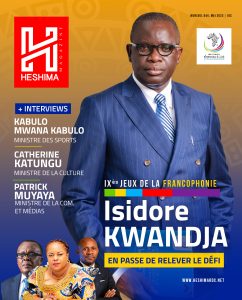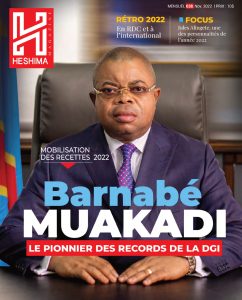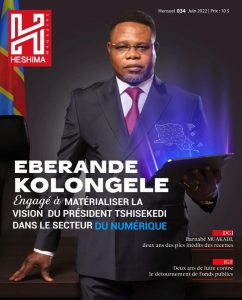Figure de proue du Mouvement du 23 mars (M23), Lawrence Kanyuka incarne aujourd’hui l’une des voix les plus audibles d’un groupe armé qui, depuis plus d’une décennie, attise les tensions dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Sous l’apparence d’un porte-parole politique rompu à l’exercice diplomatique, Kanyuka se déploie sur plusieurs fronts, mêlant stratégie médiatique, intérêts économiques occultes et réseaux transnationaux. Mais derrière cette posture policée se dessine le portrait d’un homme au cœur d’un système complexe de prédation, de violence et de pillage des ressources, dont les ramifications s’étendent bien au-delà des frontières congolaises.
Lawrence Kanyuka n’a pas toujours été l’étendard du M23. Avant de devenir une figure controversée, il fut membre actif de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), le parti de Vital Kamerhe, alors perçu comme un pilier de l’opposition démocratique en RDC. Son parcours au sein de l’UNC, bien que relativement discret, témoignait d’une ambition politique dans un contexte congolais marqué par des luttes de pouvoir intenses. Cependant, en 2013, une rupture brutale intervient : accusé de collusions avec des groupes armés, Kanyuka est exclu du parti. Ce moment charnière marque un tournant décisif dans sa trajectoire.
Plutôt que de chercher à réintégrer les cercles politiques conventionnels, Kanyuka choisit la voie de la rébellion. Son ralliement au M23 coïncide avec une période de réorganisation du mouvement, qui, après sa défaite militaire face à l’armée congolaise et à la Mission des Nations unies (MONUSCO) en 2013, maintient des réseaux dormants soutenus par des appuis extérieurs, notamment du Rwanda. Selon les rapports des Nations unies et d’ONG comme Human Rights Watch, le M23 n’a jamais véritablement disparu, continuant à opérer à travers des structures clandestines et des alliances transfrontalières. Kanyuka, avec son profil d’intellectuel et son aisance rhétorique, devient un atout stratégique pour redonner une façade politique à un groupe perçu comme une milice brutale.
L’homme des mots… et des non-dits
Promu porte-parole adjoint, puis porte-parole politique du M23 en 2022, Kanyuka s’impose comme l’architecte de la communication du mouvement. Sa mission : réhabiliter l’image du M23 auprès de la communauté internationale. Dans ses prises de parole, souvent relayées sur des plateformes comme X, il déploie une rhétorique savamment calibrée, évoquant des cessez-le-feu, plaidant pour des dialogues inclusifs, et dénonçant l’« immobilisme » du gouvernement de Kinshasa. Il se présente comme le défenseur des Tutsis congolais, qu’il qualifie de marginalisés, tout en minimisant le recours à la violence par le M23.
Pourtant, ce discours contraste violemment avec la réalité du terrain. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les offensives du M23 ont provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes depuis 2022. Les rapports onusiens, corroborés par Amnesty International et Human Rights Watch, documentent des exactions massives dans les zones sous contrôle du M23 : exécutions sommaires, viols, enrôlement forcé d’enfants, pillages systématiques et réquisitions de terres. Dans les zones sous contrôle du mouvement, comme la cité de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru ou encore Chengerero, le M23 impose une « gouvernance alternative », un euphémisme pour masquer une occupation de facto qui viole la souveraineté congolaise.
Kanyuka, dans ses déclarations, présente cette mainmise comme une nécessité pour protéger les populations locales. Mais, comme le souligne le site d’enquêtes « Off Investigation », cette rhétorique sert à dissimuler un projet territorial soutenu par des acteurs extérieurs, notamment le Rwanda, accusé par l’ONU de fournir armes, financements et même soldats au M23. En février 2025, lors de la prise de Goma par le M23, Kanyuka s’est adressé à la foule dans un discours retransmis par l’AFP, vantant une « nouvelle ère de stabilité ». Cette mise en scène, loin de refléter un consensus populaire, a exacerbé les tensions et alimenté les accusations de manipulation médiatique.
Un acteur clé du commerce des « minerais de sang »
L’histoire de Lawrence Kanyuka ne se limite pas à la sphère politique ou médiatique. Elle est intimement liée aux logiques économiques d’un conflit enraciné dans l’exploitation des ressources naturelles de l’Est congolais. Selon l’enquête d’Off Investigation, Kanyuka est à la tête d’une société de conseil minier basée à Paris, Kingston Holding, créée en 2017. Cette entreprise, enregistrée dans un contexte où Kanyuka était déjà un membre actif du M23, n’a jamais déposé ses comptes, une irrégularité qui n’a curieusement pas attiré l’attention des autorités fiscales françaises. Par ailleurs, Kanyuka détient également Kingston Fresh Ltd, une entité enregistrée au Royaume-Uni, soupçonnée d’être impliquée dans l’exportation de minerais.
Ces structures opèrent dans des filières stratégiques, notamment le coltan, l’or et le cobalt, des ressources abondantes dans les zones contrôlées par le M23, comme Rubaya, où le groupe a instauré une administration parallèle pour taxer les mineurs artisanaux. Off Investigation révèle que Kingston Holding aurait servi de canal pour exfiltrer des « minerais de sang », des ressources extraites dans des conditions de violence et de violation des droits humains vers les marchés occidentaux. Ce commerce illicite, qui transite souvent par le Rwanda voisin, alimente un système de rente permettant au M23 de financer ses activités militaires.
L’enquête pointe également des défaillances troublantes du fisc français. Alors que Kanyuka, également détenteur de la nationalité britannique, disposait d’un pied-à-terre à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne, aucune investigation sérieuse n’a été menée sur ses activités. Cette inaction contraste avec les sanctions imposées en février 2025 par les États-Unis, via le département du Trésor, qui ont ciblé Kanyuka et ses entités pour leur rôle de « facilitateur financier » du M23. L’Union européenne a emboîté le pas, gelant les avoirs de plusieurs cadres du mouvement, dont Kanyuka. Pourtant, ces mesures, bien que symboliques, peinent à démanteler un réseau qui prospère grâce à des complicités internationales.
Le conflit congolais, comme le note Off Investigation, ne peut être réduit à une lutte pour les minerais. Les tensions ethniques, les séquelles du génocide rwandais de 1994 et les faiblesses de l’État congolais jouent un rôle central. Cependant, les ressources minières qualifiées de « scandale géologique » par certains observateurs restent un moteur incontournable. Le coltan, essentiel à la fabrication des smartphones, représente à lui seul un enjeu stratégique mondial. La RDC, qui détient 80 % des réserves mondiales, voit ses richesses pillées par des groupes armés comme le M23, avec la complicité implicite de certains acteurs internationaux.
Instrumentalisation ethnique et ambitions personnelles
Dans ses discours, Kanyuka se pose en défenseur des Tutsis congolais, une communauté qu’il décrit comme victime de discriminations systématiques. Ce positionnement, s’il trouve un écho auprès de certains jeunes Tutsis désabusés, est vivement critiqué par des leaders communautaires qui rejettent l’instrumentalisation de leur identité. En réalité, les actions du M23 ont exacerbé les clivages ethniques, provoquant des représailles contre les Tutsis dans d’autres régions et alimentant une spirale de méfiance.
L’enquête d’Off Investigation cite David Maenda Kithoko, un réfugié politique congolais en France, qui dénonce une « industrialisation de la mise à mort des Congolais » orchestrée par des acteurs comme Kanyuka. Ce dernier, en se présentant comme un médiateur, contribue à brouiller les pistes d’une réconciliation véritable, tout en servant ses propres ambitions. Son aisance à naviguer entre Kigali, Paris, Londres et Dubaï témoigne d’une stratégie personnelle qui transcende les revendications communautaires.
Complicités internationales et impunité
L’un des aspects les plus troublants révélés par Off Investigation est la passivité de certains États face aux activités de Kanyuka. En France, où il a vécu plusieurs années, aucune enquête sérieuse n’a été ouverte sur Kingston Holding, malgré les soupçons de blanchiment de minerais. Cette inertie alimente les accusations de complaisance, voire de connivence, entre la France, le Rwanda et le M23. Le 28 janvier 2025, l’ambassade de France à Kinshasa a été attaquée par des manifestants dénonçant l’inaction de Paris face à l’avancée du M23 sur Goma. Ces tensions reflètent un sentiment d’abandon parmi les Congolais, qui perçoivent la communauté internationale comme complice par son silence.
Le rôle du Rwanda, accusé par Kinshasa et l’ONU de soutenir le M23, est un autre point de friction. Off Investigation mentionne la plainte déposée par le président Félix Tshisekedi contre Apple à Paris et Bruxelles, accusant le géant américain d’exploiter des minerais extraits par le M23 et blanchis via le Rwanda. Bien que cette plainte ait été classée sans suite à Paris en février 2025, elle illustre la complexité des réseaux transnationaux impliquant des entreprises technologiques, des groupes armés et des États complices.
Quel avenir pour cet homme aux multiples visages ?
Lawrence Kanyuka n’est ni un simple porte-voix du M23 ni un businessman isolé. Il incarne une figure hybride, à la croisée des sphères politique, financière et médiatique, au service d’un projet de subversion de l’État congolais. Son influence, bien que non élective, s’étend grâce à un réseau savamment entretenu entre Kigali, Dubaï, Paris et Londres. Comme le souligne Off Investigation, des figures comme Kanyuka prospèrent dans un système où le chaos devient une source de profit, et où la diplomatie se confond avec la propagande.
La pacification de l’Est congolais reste un mirage tant que les mécanismes permettant à de tels acteurs d’opérer en toute impunité ne seront pas démantelés. Cela nécessite une stratégie globale ciblant les têtes politiques, les ramifications économiques et les complicités transfrontalières. Les sanctions internationales, bien qu’utiles, ne suffisent pas si elles ne s’accompagnent pas d’une volonté politique de traquer les réseaux financiers et de renforcer la gouvernance congolaise.
Kanyuka n’est pas un phénomène isolé. Il est le produit d’un écosystème où la guerre est un commerce, et où les ressources de la RDC qualifiées par certains de « malédiction », attirent les convoitises du monde entier. La communauté internationale, si elle souhaite rompre avec des décennies d’inaction, devra cesser de fermer les yeux sur les Kanyuka de ce monde et affronter la vérité d’un conflit qui, sous couvert de revendications locales, sert des intérêts globaux.
Heshima Magazine

 International4 semaines ago
International4 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago
 International2 semaines ago
International2 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago
 Non classé2 semaines ago
Non classé2 semaines ago
 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines ago