Annoncé depuis plus de deux décennies comme le projet qui transformera la République démocratique du Congo (RDC) en « géant énergétique de l’Afrique », le barrage Inga III peine à voir le jour. Entre ambitions colossales, retards chroniques, luttes d’intérêts et doutes environnementaux, l’un des plus grands projets hydroélectriques du monde oscille entre rêve de puissance et mirage industriel. Entre-temps, l’Ethiopie concrétise un projet similaire avec le barrage de la Renaissance.
Sur les rives puissantes du fleuve Congo, à 225 kilomètres de Kinshasa, les eaux grondent au pied des chutes d’Inga. C’est ici que devait s’élever Inga III, le plus ambitieux projet hydroélectrique jamais conçu en Afrique. Mais plus de vingt ans après son lancement officiel, le chantier reste une promesse inachevée, symbole des contradictions d’un pays riche en ressources mais pauvre en infrastructures. « Inga III devait changer le destin du Congo », soupire Jean-Pierre Mbayo, ingénieur à la retraite de la Société nationale d’électricité (SNEL). « Aujourd’hui, on parle encore d’études, de financements, de consortiums… mais pas de béton coulé », a-t-il ajouté d’un air dépité.
Un rêve ancien, des promesses répétées
Le complexe hydroélectrique d’Inga ne date pas d’hier. Les deux premiers barrages, Inga I (1972) et Inga II (1982), devaient déjà propulser la RDC dans l’ère de l’électrification continentale. Mais les années de crise politique, de mauvaise gestion et de guerres successives ont freiné toute expansion. L’idée d’Inga III refait surface dans les années 2000, sous Joseph Kabila, avec un objectif colossal : produire 11 000 mégawatts d’électricité, soit de quoi alimenter non seulement la RDC, mais aussi une partie de l’Afrique australe. Le projet est alors rebaptisé « Grand Inga », censé à terme atteindre 40 000 MW, devenant ainsi le plus grand barrage du monde.
« Sur le papier, c’est un Eldorado énergétique », commente Agnès Mboyo, chercheuse à l’Université de Kinshasa. « Mais dans la réalité, la gouvernance, les financements et la planification environnementale n’ont jamais été à la hauteur des ambitions. »
Le projet rencontre également deux types d’opposition : sur le plan environnemental et deuxièmement son intérêt semble limité aux seuls miniers. D’après le reporter d’Africanews télévision, Chris Ocamringa, ce vaste projet hydroélectrique a été critiqué par certains militants de la société civile qui pensent que ce projet répondra plus aux besoins des investisseurs miniers que des Congolais de manière générale. Des populations riveraines craignent également des expropriations mais aussi pour leurs activités champêtres.
Ben Munanga, président du conseil d’administration du géant minier KAMOA Copper S.A, rejette les accusations selon lesquelles la production de l’électricité du projet Inga 3 ira à 100 % aux miniers. « Il est dit nulle part dans le projet que toute la production ira à l’opérateur minier », a-t-il réfuté.
Des partenaires nombreux, mais aucune mise en œuvre concrète
Au fil des ans, Inga III a vu défiler les partenaires : Chine, Espagne, Afrique du Sud, Banque mondiale, Union africaine. Chaque accord semblait marquer un tournant, avant de retomber dans le flou. La Banque mondiale s’est même retirée du projet en 2016, évoquant « un manque de transparence dans la conduite du dossier ». Sous Félix Tshisekedi, les discussions ont repris avec un consortium sino-espagnol, mais les négociations patinent.
Le gouvernement affirme vouloir reconfigurer le projet pour répondre d’abord aux besoins nationaux – un changement stratégique face à l’opinion publique, lassée de voir le courant partir à l’étranger alors que moins de 20 % des Congolais ont accès à l’électricité. « Il est impensable que le Congo exporte l’électricité alors que nos villages vivent encore dans le noir », avait déclaré un coordonnateur d’une ONG de défense de l’environnement. « Inga doit d’abord servir le peuple congolais. »
Un projet pharaonique… et controversé
Derrière les promesses, les critiques se multiplient. Les organisations écologistes redoutent un désastre environnemental sur le fleuve Congo, le deuxième plus puissant du monde après l’Amazone. Les ONG locales, quant à elles, dénoncent un manque de consultation des communautés affectées par les expropriations prévues. « Le discours sur le développement masque souvent la réalité : des familles déplacées, des écosystèmes détruits et des contrats opaques », dénonce Marie-Louise Kebi, militante d’un collectif pour la préservation des eaux du fleuve Congo. « Inga III risque de reproduire les erreurs des grands barrages du passé », estime-t-elle.
Sur le plan financier, les chiffres donnent le vertige : le coût initial, estimé à 12 milliards puis à 14 milliards selon les dernières projections. Dans un contexte de dette publique croissante et de corruption endémique, beaucoup doutent de la viabilité économique du projet.
Le symbole d’un pays à la croisée des chemins
Pour ses défenseurs, Inga III reste une chance historique. « Le Congo ne peut pas renoncer à son rôle de puissance énergétique », plaide Germain Kabeya, économiste. « Si nous réussissons Inga, nous devenons le cœur électrique de l’Afrique. » Mais pour d’autres, ce rêve industriel ne doit pas faire oublier les priorités immédiates : électrification rurale, maintenance des réseaux existants, et lutte contre les pertes massives d’énergie (près de 40 % selon la SNEL).
« L’énergie ne se mesure pas en mégawatts produits, mais en foyers éclairés », rappelle Élodie Manda, une ingénieure électromécanicienne. « Tant que Kinshasa restera éclairée et Kikwit dans le noir, Inga restera un mirage », a-t-elle ajouté. Devant cette réalité amère, l’administration Tshisekedi a changé le fusil d’épaule. En attendant Inga III, le gouvernement a créé ANSER : une Agence nationale de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain. Elle vise à atteindre 30 % d’électrification des milieux ruraux et périurbains en 2025 et 50 % d’ici à 2030. Grâce à l’énergie solaire, cette structure a déjà apporté de l’électricité à Lodja, au Sankuru. Réputé un des trous noirs du pays, ce chef-lieu de la province a été éclairé avec notamment une partie de Lumumbaville, une nouvelle ville créée en hommage à Patrice Emery Lumumba, à Onalua.
Inga III : le barrage du siècle… ou du siècle prochain ?
En 2025, Inga III n’est encore qu’un projet en attente de financement définitif, malgré des décennies d’études et de promesses politiques. Entre tensions géopolitiques, retards administratifs et défi de gouvernance, le barrage du siècle reste suspendu entre deux réalités : celle du rêve national et celle du doute collectif. « Le fleuve, lui, continue de couler », sourit amèrement un ingénieur qui renvoie ce projet aux calendes grecques suite aux nombreux défis qui se dressent au pays.
Pourtant, dans la Corne de l’Afrique, un pays a décidé et s’est donné les moyens d’y parvenir sans trop attendre l’aide extérieure : l’Ethiopie. Démarrés en 2010, les travaux ont duré 14 ans. Le Grand barrage de la Renaissance est aujourd’hui un projet hydroélectrique majeur construit par l’Éthiopie sur le Nil Bleu. Ce barrage est devenu une source de tensions géopolitiques avec les pays en aval du Nil, notamment l’Égypte et le Soudan. Le barrage est officiellement inauguré en septembre 2025, mais des turbines sont opérationnelles depuis 2022, produisant de l’électricité pour l’Éthiopie et ayant pour objectif l’exportation d’énergie dans la région. L’Égypte et le Soudan craignent que le barrage ne réduise leur approvisionnement en eau et cherchent à trouver un accord avec l’Éthiopie.
Heshima

 Non classé3 semaines ago
Non classé3 semaines ago
 Nation4 semaines ago
Nation4 semaines ago
 Economie2 semaines ago
Economie2 semaines ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago
 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago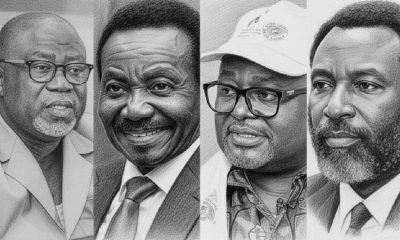
 Nation3 jours ago
Nation3 jours ago
 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines ago
































































