Economie
Willy Kitobo maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques
En prenant les rênes du ministère stratégique des Mines le 9 septembre 2019, le professeur Willy Kitobo Samsoni avait promis d’impulser le secteur minier congolais en y imposant une nouvelle dynamique en termes de mobilisation des recettes publiques. Une année et quelques mois après, le successeur de Martin Kabwelulu a su imprimer ses marques, gagnant son pari malgré les effets pervers du coronavirus.
Published
5 ans agoon
By
La redaction
L es annales témoignent des résultats du sens élevé de gestion et d’organisation du secteur minier de Willy Kitobo Samsoni, tant du point de vue de la production minière que des ressources financières générées. D’après les données statistiques de la Banque centrale du Congo (BCC), par exemple, la production du cuivre a atteint 1 322 millions de tonnes fin octobre 2020, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période en 2019. Les sociétés minières de la RDC ont produit globalement 51 235 tonnes de cobalt fin août 2020 alors qu’en 2019, la production était de 50 714 tonnes. À coup sûr, l’impact du code minier révisé sur les recettes publiques est flamboyant. Selon le secrétaire général aux Mines, Yombo Y’Apeke, les opérateurs miniers ont rapatrié en RDC 8,81 milliards de dollars sur les recettes d’exportation estimées à 12, 567 milliards de dollars. Le prix de cobalt au 25décembre 2020 est de 32 190 dollars par tonne. En septembre, le cours du cuivre était de 6 372 dollars la tonne. D’après le ministère des Finances, le secteur minier avait contribué au budget national à hauteur de 1,57 milliards de dollars en 2018. La RDC étant le premier producteur mondial du cobalt, le gouvernement par le biais du ministère des Mines est déterminé, avec les marques qu’imprime le professeur Kitobo, à faire mieux.
Vulgarisation de la loi de 2018
Par rapport à ses attributions, Willy Kitobo a bien appliqué le programme du gouvernement en matière de législation minière, renforçant la souveraineté de l’Etat dans ledit domaine en dépit de l’hostilité des multinationales sur l’application du code minier de mars 2018. Depuis la promulgation de celui-ci, les géants miniers que sont Randgold Resources, Glencore, Ivanhoe Mines, Gold Mountain international/Zijin Mining Group, MMG Limited, Crystal River Global Ltd and China Molybdenum Co., Ltd (CMOC) et AngloGold Ashanti, ressassent toujours l’ancienne législation et demandent à l’Etat congolais de revenir à celle-ci. Ils n’ont jamais digéré l’instauration de la redevance de 10 % sur les substances minérales considérées comme stratégiques (cobalt, germanium, coltan…). En appliquant la loi, le ministre Kitobo ne fait en réalité qu’agir conformément à la vision du chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait déclaré en 2019 que : « Le code minier fait en sorte que le peuple congolais soit le premier bénéficiaire. J’attends pérenniser cette loi ».

Toujours dans le même cadre de la vulgarisation du code minier révisé, le ministre Willy Kitobo a effectué plusieurs de descentes sur le terrain pour parler aux miniers de l’application effective du nouveau code ainsi que de la loi sur la sous-traitance et le paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées. Tour à tour, en tant que ministre national des Mines, il s’était rendu à Kolwezi, Lubumbashi, Kambove, Goma, Watsa, Doko… Une tâche ardue quand on sait que certains opérateurs désobéissent aux dispositions légales et plusieurs autres ne s’acquittent pas du paiement de leurs obligations dans le délai légal. Sur le terrain, il est arrivé au ministre d’arbitrer certains litiges opposant les communautés délocalisées ou affectées par de projets miniers aux entreprises minières. Certaines missions, il les a effectuées conjointement avec ses collègues dont le ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale et celui de l’Industrie, en vue de sauvegarder les activités minières pendant la période de coronavirus.
Des mesures importantes de redynamisation
Le 15 septembre 2020, Willy Kitobo Samsoni a signé deux arrêtés ministériels, l’un portant restructuration de la mise en place des chefs de divisions provinciales des Mines et Géologie du secrétariat général de son ministère. L’autre, sur la restructuration de l’installation des directeurs-chefs de services.
En novembre 2019, le gouvernement avait pris deux décrets édictant des mesures de renforcement de la règlementation de l’activité artisanale des substances minérales stratégiques et créant l’ARECOMS (Autorité de régulation et contrôle des marchés des substances minérales stratégiques) et l’EGC (Entreprise Générale du Cobalt), deux structures d’assainissement et de formalisation de l’exploitation du cobalt artisanal. Concernant la procédure de traçabilité et certification des gisements des minerais, tous les contrats miniers sont rendus publics dans le site web du ministère et de la cellule technique de la coordination et de planification.

Ouverture du secteur des mines aux investisseurs
Durant une année, Willy Kitobo a abattu un grand travail pour l’attractivité de son secteur. Le 07 octobre 2019, l’ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer était son hôte. Avec le diplomate américain, le professeur Willy Kitobo a parlé de l’investissement des entrepreneurs américains au Congo, notamment dans le domaine minier. Après la visite du Président Tshisekedi à Bruxelles, il avait échangé avec l’ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Jo Indekeu.
Il a également eu une séance de travail avec l’ambassadeur de Suisse en RDC, Roger Denzer et ainsi qu’avec une délégation de la République de l’Inde, conduite par son ambassadeur Nina Tshering.
En octobre 2020, le professeur Kitobo était en visite, à Genève, en Suisse, au Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité (DCAFF). Le DCAFF est une structure d’accompagnement au processus d’adhésion aux principes volontaires de respect des droits et de sécurité dans le secteur extractif. Aussi, il s’était entretenu avec les membres de Global Battery Alliance, autour de la lutte contre le travail des enfants dans les mines de cobalt artisanal en RDC, secteur dans lequel il existe plusieurs centaines de milliers de creuseurs.
Redynamisation du secteur
Concernant la relance des entreprises minières du portefeuille de l‘Etat dont la Société Minière de Bakwanga (MIBA) et la SOKIMO, le ministre Willy Kitobo a échangé respectivement avec les caucus des députés du Kasaï Oriental et de l’Ituri. A son arrivée à la tête du ministère, il s’était penché sur le dossier de la relance de la Société des Mines d’or de Kilo-Moto (SOKIMO). Les autres services dépendant des mines comme le Centre d’expertise d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC) ont été aussi redynamisés.
Forums, ateliers et conférences
Outre le fait d’assurer le suivi et les contrôles techniques des activités minières sur toute l’étendue de la République, le ministre des Mines a participé à plusieurs forums et a initié ou lancé de nombreux ateliers et conférences. Il a organisé des formations avec plusieurs modules pour faire comprendre les dispositions du code minier qui garantissent les intérêts de l’Etat, propriétaire de l’ensemble de gîtes des substances minérales, les intérêts des entreprises minières et aussi les intérêts des communautés locales affectées par les projets miniers. Une formation de renforcement des capacités des agents du secteur minier ayant comme attribution la répression des infractions minières a aussi été organisée pendant quatre jours à l’intention des OPJ et APJ.
Olyncia MUHONG
You may like
-


Assemblée nationale : une session de mars potentiellement explosive
-


L’économie congolaise déjà impactée par la guerre
-


Opposition en RDC : Kabila, Katumbi et Fayulu, un front uni pour préserver la Constitution ?
-


Thérèse Kayikwamba, la « Kimpa Vita » de la diplomatie congolaise
-


Autosuffisance alimentaire Lovo, la nouvelle pépite du Service national
-


RDC : Goma assiégée par l’armée rwandaise, Washington promet des sanctions
Economie
Subventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix
Published
4 semaines agoon
août 22, 2025By
La redaction
La République démocratique du Congo (RDC) maintient depuis plusieurs années une politique de subvention massive des prix du carburant afin de préserver la stabilité à la pompe et le pouvoir d’achat des ménages. Mais cette stratégie, saluée pour son impact social immédiat, exerce une pression considérable sur les finances publiques, alerte la Banque mondiale dans son dernier rapport. En pratique, ce mécanisme creuse l’endettement de l’État, qui cumule des arriérés de plusieurs centaines de millions de dollars envers les importateurs. Une situation qui inquiète les institutions financières internationales, à commencer par celles de Bretton Woods.
Dans son rapport sur la situation économique en RDC, rendu public fin juillet, la Banque mondiale a alerté sur les risques de détérioration de l’économie congolaise, notamment en raison du conflit qui perdure dans l’est du pays. Parmi les menaces identifiées figure la subvention des manques à gagner accordée aux pétroliers.
En compensant ces pertes, Kinshasa vise à maintenir un prix bas à la pompe pour les consommateurs. L’État intervient ainsi pour éviter une flambée des tarifs, dans un contexte où le taux de change pénalise les importateurs et où les coûts logistiques et macroéconomiques restent élevés. Sans ces aides, le litre d’essence avoisinerait 5 300 à 5 400 francs congolais. Mais l’impact sur l’économie et les finances publiques est jugé préoccupant par l’institution financière internationale. Un mois plus tôt, le FMI avait déjà mis en garde le gouvernement contre les risques liés à cette politique de subvention.
Une dépense de 300 millions USD en 2024
Selon la Banque mondiale, les subventions directes au carburant ont coûté environ 300 millions de dollars à l’État congolais en 2024. D’après les chiffres transmis par le gouvernement au FMI, 288 millions de dollars ont été remboursés cette année-là au titre d’arriérés partiels datant de 2023.
En 2025, près de 270 millions supplémentaires ont été versés pour solder le solde de la dette de 2023 ainsi que les créances des deux premiers trimestres de 2024. Ces deux plus gros remboursements ont été effectués grâce à des prêts bancaires syndiqués : 145 millions de dollars débloqués en février 2024 et 214 millions en novembre 2024. À cela s’ajoute un manque à gagner fiscal estimé à 86,8 millions de dollars par an, soit environ 0,1 % du PIB, selon les autorités citées par la Banque mondiale.
Les subventions perturbent les finances du pays
Si elles permettent de maintenir la stabilité des prix à la pompe, les subventions pétrolières pèsent lourd sur les finances publiques. En 2022, plus de 400 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement à ce titre, alors que seulement 80 millions étaient inscrits au budget. Le ministre des Finances de l’époque, Nicolas Kazadi, expliquait alors que l’enveloppe prévue ne suffisait pas à apurer la dette de l’État envers les opérateurs pétroliers.
Depuis plus de trois ans, le FMI exhorte Kinshasa à réformer ce système jugé trop coûteux. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, défendait ces subventions, arguant qu’elles visent à contenir les prix des biens et services. « 40 % du prix du carburant que vous consommez est payé par l’État. Lorsque le carburant prend l’ascenseur, tout prend l’ascenseur. En contenant son prix, nous agissons directement sur le quotidien des ménages », expliquait-il en 2022.
Parmi les pistes envisagées figure la mise en place d’un cadre permettant d’ajuster les prix des carburants en fonction de leurs coûts réels. Mais, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, ce mécanisme « n’est pas pleinement appliqué », ce qui maintient des tarifs artificiellement bas et creuse les dépenses publiques. D’où la nécessité, selon Mercedes Vera Martin, cheffe de mission du FMI pour la RDC en 2022, de réformer ce système de subventions afin d’en limiter le coût et de le remplacer par des aides ciblées en faveur des ménages les plus vulnérables. Elle préconisait alors de réorienter ces fonds vers les besoins prioritaires : santé, éducation et investissements dans des infrastructures essentielles.
Des coûts des subventions allégés en 2025
En août 2024, le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, estimait que l’État congolais supportait un manque à gagner mensuel d’environ 15 millions USD pour maintenir les prix des carburants. Ce déficit, qui avait atteint près de 40 millions USD par mois, a été sensiblement réduit. Concrètement, le gouvernement prend en charge entre 2 100 et 2 300 francs congolais par litre, afin que le prix payé par l’usager reste autour de 3 500 FC, alors que le coût réel se situe entre 5 300 et 5 400 FC.
Selon les chiffres publiés en mai 2025, les manques à gagner liés aux subventions se sont établis à 31,5 millions USD pour l’ensemble de l’année 2024, soit une baisse de 89 % par rapport aux 288 millions USD enregistrés en 2023. Pour le premier semestre 2024, la dépense s’élevait à environ 16 millions USD, un montant similaire ayant été constaté au second semestre.
« Le FMI salue les efforts du gouvernement congolais dans la réduction des pertes et manques à gagner (PMAG) du secteur pétrolier : –89 % entre 2023 et 2024 », a indiqué le compte X du ministère de l’Économie nationale. « Nous avons observé une diminution significative de ces pertes, avec un impact très positif sur les finances publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts », déclarait en mai dernier Calixte Ahokpossi, chef de mission du FMI pour la RDC.
Lutte pour la fin des subventions structurelles
Ces avancées s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à assainir et rationaliser les subventions pétrolières, afin d’assurer une gestion plus efficace et transparente des finances publiques. En 2022, un audit de la Structure des prix des produits pétroliers (SPPP) avait été confié au cabinet Mazars. Avant même la publication de ses conclusions en 2023, le gouvernement avait engagé, dès avril 2022, des mesures proactives pour contenir les dépenses publiques, notamment en excluant le secteur de l’aviation internationale de la liste des bénéficiaires.
En octobre 2023, cette rationalisation a été étendue au secteur minier, qui représentait près de 20 % des manques à gagner. À long terme, l’exécutif entend réduire progressivement l’écart entre les prix de marché et les prix de vente au détail, dans l’objectif de mettre fin aux subventions structurelles sur les produits pétroliers.
Heshima
Economie
RDC : André Wameso, un stratège économique à la tête de la BCC
Published
2 mois agoon
juillet 28, 2025By
La redaction
Le 23 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a nommé André Wameso au poste de gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), succédant à Malangu Kabedi Mbuyi. Cette nomination marque un tournant important pour l’institution monétaire du pays, alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis économiques persistants. Qui est André Wameso, et pourquoi Tshisekedi l’a-t-il choisi pour cette position clé ? Heshima Magazine revient sur ce changement à la tête de la plus grande institution financière du pays.
Un parcours riche en expérience
André Wameso, la cinquantaine révolue, originaire de Songololo dans le Kongo-Central, est un économiste de formation. Il est diplômé en ingénierie commerciale avec une spécialisation en finance de l’Université Catholique de Louvain en Belgique, une institution réputée pour son excellence académique. Sa carrière professionnelle débute dans le secteur bancaire européen, où il occupe le poste de directeur de l’audit interne chez Dexia (aujourd’hui Belfius) en Belgique. À ce titre, il supervise les contrôles internes, la conformité et l’évaluation des risques à l’international, développant une expertise pointue en gestion financière. De retour en RDC, Wameso rejoint Rawbank, l’une des principales banques commerciales du pays, en tant que directeur du risque, consolidant ainsi son expérience dans le secteur bancaire congolais.
Au-delà de ses réalisations dans le privé, Wameso s’est distingué dans l’administration publique. Avant sa nomination à la BCC, il occupait depuis avril 2021 le poste de directeur de cabinet adjoint du président Tshisekedi, chargé des questions économiques et financières. Auparavant, il était l’un des cinq ambassadeurs itinérants du chef de l’État, chargé de missions diplomatiques et économiques à travers le monde. Élu député national lors des dernières élections législatives, il choisit de ne pas siéger à l’Assemblée nationale pour conserver ses responsabilités au sein du cabinet présidentiel, démontrant son engagement envers les priorités économiques de Tshisekedi.
Wameso a également joué un rôle dans la révision du contrat sino-congolais, un dossier stratégique suivi par l’Inspection générale des Finances, renforçant son image de technocrate rigoureux.
Un choix stratégique de Félix Tshisekedi
La nomination de Wameso à la tête de la BCC n’est pas un simple changement de personnel, mais un signal politique fort, comme l’a souligné un proche du sérail du pouvoir dans un post sur le réseau social X le 26 juillet 2025 : « Il ne s’agit pas d’un simple remplacement, mais d’un signal politique fort. » Cette décision s’inscrit dans un contexte où l’économie congolaise est confrontée à des enjeux complexes, mêlant défis internes et engagements internationaux. Wameso est perçu comme un collaborateur de confiance du président, doté d’une expertise technique et d’une expérience diplomatique précieuse.
Un élément central de son profil est son rôle clé dans la négociation de l’accord historique entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025. Cet accord, visant à promouvoir la paix et la coopération économique dans la région des Grands Lacs, riche en minéraux critiques comme le coltan, positionne la RDC comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Selon Reuters, cet accord « marque une percée dans les pourparlers et vise à attirer des milliards de dollars d’investissements occidentaux dans une région riche en cobalt ». Wameso, décrit comme un « négociateur central » par certaines sources, a démontré sa capacité à gérer des dossiers sensibles impliquant des enjeux géopolitiques et économiques.
Sa proximité avec le président Tshisekedi, combinée à son expérience dans la coordination des politiques économiques nationales, fait de lui un choix logique pour traduire les engagements internationaux en résultats concrets au niveau national. Cette nomination reflète également la volonté de Tshisekedi de placer des figures de confiance à la tête des institutions clés, comme le souligne Congoprofond.net, qui qualifie cette vague de nominations de « remaniement stratégique ».
Les défis de la BCC
La Banque Centrale du Congo fait face à des défis colossaux pour assurer la stabilité monétaire et financière de la RDC. Selon ses données, le taux d’inflation glissement annuel s’élevait à 7,882 % le 26 juillet 2025, une amélioration par rapport aux 11,3 % de fin 2024, mais toujours préoccupante. Cette baisse, rapportée par la Banque mondiale, résulte d’une meilleure gestion des réserves de change, portées à 2,5 mois d’importations en 2024 grâce aux investissements directs étrangers et aux financements extérieurs.
La stabilisation du taux de change reste une priorité. Le franc congolais (CDF) a subi une dépréciation de 8,7 % en 2024, selon la Banque mondiale, et le taux de change s’établissait à 1 USD = 2 874,8680 CDF le 25 juillet 2025, d’après la BCC. Cette volatilité affecte le pouvoir d’achat des Congolais et la confiance dans la monnaie nationale. La dollarisation de l’économie, où de nombreuses transactions sont effectuées en dollars américains, limite l’efficacité de la politique monétaire, comme le note Dac-presse.com : « Le franc congolais fait face à de multiples défis économiques, notamment l’inflation, le taux de change instable et la dollarisation de l’économie ».
Wameso devra également poursuivre les réformes institutionnelles initiées par sa prédécesseure, Malangu Kabedi Mbuyi, qui ont permis de réduire l’inflation de 23,8 % en 2023 à 6,2 % en 2024, selon Infos27.cd. Ces réformes incluent le renforcement de la gouvernance de la BCC et l’assainissement du système bancaire, des objectifs cruciaux pour répondre aux attentes du Fonds Monétaire International (FMI). Un rapport du FMI publié le 2 juillet 2025 souligne que « la BCC a maintenu une orientation restrictive de la politique monétaire, contribuant à ramener l’inflation à un chiffre pour la première fois en trois ans ».
Enfin, la coordination avec la politique budgétaire est essentielle, dans un contexte où le budget national dépend fortement du secteur minier (plus d’un tiers des recettes) et de l’aide extérieure, attendue à hauteur de 27 % en 2025, selon le Trésor français.
Wameso face aux attentes
Avec son bagage académique et son expérience professionnelle, André Wameso semble bien équipé pour relever ces défis. Son expertise en gestion des risques et en audit interne, acquise chez Dexia et Rawbank, sera précieuse pour renforcer la transparence et la crédibilité de la BCC. Sa participation à des dossiers stratégiques, comme la révision du contrat sino-congolais et l’accord RDC–USA–Rwanda, témoigne de sa capacité à naviguer dans des environnements complexes.
Sa proximité avec le pouvoir exécutif pourrait faciliter la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, un facteur clé pour maintenir la stabilité macroéconomique. Comme le note Zoom-eco.net, « la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires sera cruciale pour maintenir cette tendance positive » en matière de contrôle de l’inflation.
Cependant, des critiques émergent, notamment sur les réseaux sociaux, où certains Congolais, comme Wini Sadewa sur X, questionnent la valeur ajoutée de Wameso : « N’était-il pas déjà dans le système ? Quelle réelle plus-value a-t-il apportée, concrètement ? Juste un poste ? » D’autres, comme Patrick Santu, doutent de son expertise spécifique pour diriger une banque centrale. Ces réserves reflètent une méfiance envers les nominations perçues comme politiques, un sentiment répandu dans un pays marqué par des décennies de gouvernance contestée.
Malgré ces critiques, le parcours de Wameso et son implication dans des dossiers stratégiques suggèrent qu’il a les compétences nécessaires pour diriger la BCC dans cette période critique. Son succès dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des réformes audacieuses tout en répondant aux attentes élevées des Congolais et des partenaires internationaux.
Un cap pour la stabilité monétaire ?
La nomination d’André Wameso à la tête de la BCC est un choix stratégique de la part du président Tshisekedi, visant à placer un expert de confiance pour gérer les défis monétaires et économiques de la RDC. Avec son parcours riche et diversifié, Wameso est bien positionné pour stabiliser le franc congolais, contrôler l’inflation et renforcer le système bancaire. Toutefois, il devra faire face à des attentes élevées et à des critiques, tout en naviguant dans un environnement économique et politique complexe. Dans un pays où la souveraineté monétaire est aussi un levier de souveraineté politique, comme le souligne Daniel Kleber, Wameso a l’opportunité de marquer l’histoire de la BCC.
Heshima Magazine
Economie
Economie : Comment lutter efficacement contre l’évasion fiscale en RDC ?
Published
2 mois agoon
juillet 16, 2025By
La redaction
La République démocratique du Congo (RDC), riche en ressources naturelles, fait face à un défi de taille : l’évasion fiscale. Ce fléau prive le pays de milliards de dollars nécessaires pour financer les services publics et les infrastructures, exacerbant la pauvreté et freinant le développement. Alors que le gouvernement s’efforce de tirer parti de ses richesses minières, la lutte contre l’évasion fiscale devient une priorité nationale. Heshima Magazine explore la nature de l’évasion fiscale en RDC, son impact économique, ainsi que les mesures actuelles pour la combattre.
L’évasion fiscale se définit comme le non-paiement ou le sous-paiement illégal des impôts, souvent par des pratiques telles que la sous-déclaration des revenus, l’inflation des déductions ou l’utilisation de comptes offshore. En RDC, ce phénomène est particulièrement marqué dans le secteur minier, où les richesses en cuivre, cobalt et diamants attirent des acteurs cherchant à maximiser leurs profits au détriment du trésor public. Selon un rapport de Global Witness publié en 2017, entre 2013 et 2015, 750 millions de dollars de revenus miniers n’ont pas atteint le trésor national en raison de la corruption et de la mauvaise gestion. Ces fonds, détournés par des réseaux impliquant des agences fiscales et la société minière étatique Gécamines, illustrent l’ampleur du problème.
Le secteur minier n’est pas le seul concerné. Comme le souligne un rapport du Département d’État américain, les politiques fiscales et douanières inefficaces, combinées à des salaires publics chroniquement bas, favorisent un climat de corruption et de transactions clandestines, notamment dans les activités d’import-export. Cette situation est aggravée par la complexité du système fiscal, qui pousse plus de la moitié des entreprises interrogées à offrir des cadeaux aux agents fiscaux pour faciliter leurs démarches, selon un rapport de GAN Integrity publié en 2020.
L’impact de l’évasion fiscale sur l’économie congolaise
L’évasion fiscale a des conséquences dévastatrices sur l’économie de la RDC. Avec un ratio impôts/PIB de seulement 13,7 % en 2023, selon un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) publié en juillet 2024, la RDC se situe bien en deçà de nombreux pays pairs. Ce faible ratio limite les ressources disponibles pour des secteurs cruciaux comme la santé, l’éducation et les infrastructures, dans un pays où 73,5 % de la population vivait avec moins de 2,15 dollars par jour en 2024, selon la Banque mondiale.
Le FMI estime qu’en améliorant les politiques et l’efficacité de la collecte fiscale, la RDC pourrait augmenter son ratio impôts/PIB de 10 points de pourcentage. Avec un PIB de 66,38 milliards de dollars en 2023, cela représenterait une augmentation des recettes fiscales de 9,09 milliards à environ 15,73 milliards de dollars, soit un gain potentiel de 6,64 milliards de dollars. Ces fonds pourraient transformer les perspectives de développement du pays, permettant des investissements dans des projets d’infrastructure et des programmes sociaux.
L’évasion fiscale aggrave également les inégalités. Comme l’a noté l’Africa Progress Panel dans un rapport de 2013, l’Afrique perd deux fois plus en flux financiers illicites qu’elle ne reçoit en aide internationale, une réalité particulièrement criante en RDC, où les ressources naturelles devraient être un moteur de prospérité pour tous.
Mesures actuelles et leur efficacité
Ces dernières années, la RDC a entrepris des réformes pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Selon un communiqué du FMI publié en mai 2025, des progrès ont été réalisés dans le cadre du programme de la Facilité de Crédit Élargi, notamment grâce à une meilleure collecte de l’impôt sur les sociétés, en particulier dans le secteur extractif. Parmi les mesures phares, le gouvernement a introduit un système de facturation standardisé pour la TVA, visant à simplifier la collecte et à réduire les opportunités d’évasion. De plus, la Loi de Finances 2024, publiée par le ministère du Budget, a réduit le nombre de paiements anticipés d’impôts de quatre à trois, avec des échéances fixées au 1er août, 1er octobre et 1er décembre, pour faciliter la conformité des entreprises.
Cependant, l’efficacité de ces mesures reste limitée. La corruption endémique et la faible capacité de l’administration fiscale entravent leur mise en œuvre. Par exemple, un rapport de Reuters datant de 2014 a révélé que les entreprises opérant dans la province du Katanga devaient 3,7 milliards de dollars en droits de douane et amendes impayés entre 2008 et 2013, souvent avec la complicité des agents douaniers. De plus, la répression des lanceurs d’alerte, comme l’employé de l’agence fiscale nationale licencié en 2010 après avoir dénoncé une fraude fiscale à grande échelle, selon GAN Integrity, montre les défis structurels auxquels la RDC est confrontée.
Stratégies proposées pour lutter contre l’évasion fiscale
Pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, la RDC doit avant tout moderniser son administration fiscale. Cela passe par des investissements ciblés dans la formation et la rémunération des agents, afin de réduire les tentations de corruption. L’introduction d’outils numériques, comme les systèmes de suivi électronique des paiements, permettrait d’accroître la transparence et d’améliorer le rendement fiscal. Le FMI encourage d’ailleurs la mise en place rapide du système de facturation standardisé pour la TVA, qui pourrait considérablement limiter les fraudes liées à la sous-déclaration.
En parallèle, il est crucial de réviser le cadre légal. Une mise à jour des lois fiscales visant à combler les failles existantes, combinée à une application rigoureuse des sanctions contre les contrevenants, permettrait d’établir un environnement juridique plus crédible et dissuasif. Une justice fiscale impartiale renforcerait la confiance et réduirait les pratiques illicites.
Transparence et coopérations internationales
La transparence, notamment dans le secteur minier, est un autre pilier fondamental. La mise en place de systèmes de reporting en temps réel, appuyés par des audits indépendants, garantirait une meilleure traçabilité des revenus issus des ressources naturelles. La RDC, engagée dans l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), dispose d’un cadre international reconnu, mais son application reste encore trop timide et nécessite un engagement politique accru.
Sur le plan international, la coopération fiscale représente un levier non négligeable. Des traités signés avec des pays comme l’Afrique du Sud ou la Belgique, qui prévoient des taux réduits sur les dividendes, intérêts et redevances, facilitent l’échange d’informations fiscales et la détection des flux financiers suspects. Des accords bilatéraux plus ciblés, tels que celui conclu avec l’Angola en 2021, peuvent également contribuer à lutter contre la contrebande et améliorer la mobilisation des recettes aux frontières.
Promouvoir l’éducation fiscale et la culture de la conformité
Enfin, au-delà des dispositifs institutionnels, il est essentiel de sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance du civisme fiscal. Informer sur les obligations fiscales, tout en mettant en lumière les bénéfices concrets des recettes collectées infrastructures, santé, éducation, peut contribuer à instaurer une culture durable de conformité. Des campagnes de communication adaptées, menées en plusieurs langues et via des canaux populaires comme les radios communautaires ou les réseaux sociaux, permettraient de mieux ancrer la fiscalité dans la conscience collective.
Le rôle de la coopération internationale
La coopération internationale est un pilier essentiel de la lutte contre l’évasion fiscale en RDC. Les traités fiscaux avec l’Afrique du Sud et la Belgique, comme mentionné dans un rapport de PwC publié en octobre 2024, permettent non seulement d’éviter la double imposition, mais aussi de partager des informations cruciales pour identifier les pratiques d’évasion. De plus, les accords bilatéraux signés en 2021 avec des pays comme le Qatar, la Namibie, la Zambie et l’Angola, selon le Département d’État américain, incluent des dispositions sur la fiscalité et les douanes qui renforcent la gestion des échanges transfrontaliers.
Le soutien des organisations internationales est tout aussi crucial. Le FMI et la Banque mondiale fournissent une assistance technique et des conseils politiques pour améliorer les systèmes fiscaux de la RDC. Par exemple, lors d’une rencontre en avril 2022 avec le sous-secrétaire américain au Trésor Brian Nelson, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a discuté des réformes anti-blanchiment et de la lutte contre la corruption, selon un communiqué du Département du Trésor américain. Ces efforts internationaux renforcent la capacité de la RDC à s’attaquer aux flux financiers illicites.
Vers un système fiscal transparent ?
La lutte contre l’évasion fiscale en RDC exige une approche globale combinant des réformes internes et une coopération internationale. En renforçant l’administration fiscale, en augmentant la transparence, en mettant à jour les cadres légaux et en sensibilisant le public, le pays peut améliorer ses recettes fiscales et investir dans son développement. Comme l’a souligné le ministre des Finances Nicolas Kazadi dans une interview avec Financial Afrik en octobre 2023, « l’augmentation de la mobilisation des recettes grâce au renforcement des mécanismes de contrôle est une priorité du gouvernement ». Avec l’engagement de toutes les parties prenantes, la RDC peut progresser vers un avenir plus équitable et prospère, où les richesses de son sous-sol profitent à l’ensemble de la population.
Heshima Magazine
Trending
-

 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines agoRutshuru : quand le silence international devient complice d’un génocide rampant
-

 Nation3 semaines ago
Nation3 semaines agoAugmentation des recettes du budget 2026 : la DGI mise à contribution
-
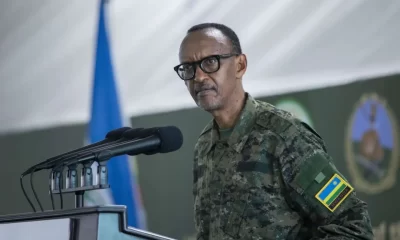
 International4 semaines ago
International4 semaines agoKigali et les FDLR : un dialogue inter-rwandais pour en finir avec la crise en RDC est-il possible ?
-

 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines agoUnion Sacrée : Tshisekedi remodèle son appareil politique
-

 Economie4 semaines ago
Economie4 semaines agoSubventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix
-

 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine agoCoupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?
-

 Nation2 semaines ago
Nation2 semaines agoRDC : Constant Mutamba, son rêve de la présidentielle 2028 brisé ?
-

 Nation1 semaine ago
Nation1 semaine agoRDC : des solutions face aux difficultés dans l’application du quitus fiscal





























































